Communication, culture et patrimoine
Personnages
- Aline Thomas
- André Llobet
- André Lorente
- Catherine Bascoul
- Christian Bouillé
- Christian Laborde
- Claire et Thierry
- Georges Doumenc
- Germaine Gispert
- Hamid Jarmouni
- Hippolyte Annex
- Jo l'Oranais
- La Marseillaise
- Lucie Bruel
- Marc Bel
- Marguerite Meyer
- Mattt Konture
- Miloud Abouhafs
- Moss
- Mounir Letaief
- Maurice Guillaume
- Pierre Rainard
- Pierre Sussi
- René Brel
- Robert Durand
- Tané Farré
- Julien Del Litto
- Le Père Bonnet
- L'Abbé Coursindel
- Lojka Mitrovic
- Pascal Moisset, Century 21
- Dari Boumédienne
- Madame Plume d'or
1- Aline Thomas
Je suis née en 1933 à Figuerolles, et j’y habite toujours. Je suis entrée à la Sainte Famille (école primaire et collège catholique) pour y apprendre à lire, et j’en suis sortie à la retraite. Je suis donc devenue institutrice après avoir passé le Brevet Elémentaire, qui m’a permis de commencer à enseigner, puis j’ai obtenu mon CAP et je suis devenue une véritable institutrice, payée par l’Education Nationale. Auparavant, j’étais très peu payée, et parfois avec beaucoup de retard. L’école n’était pas riche. J’y ai donc vu passer les enfants du quartier pendant 50 ans.Au début, la population était surtout ouvrière : des maçons, des salariés, des employés de bureau et quelques médecins et professions libérales. A partir de 1954, après la construction de la cité d’urgence, il y a eu beaucoup de gens très pauvres.
En 1962, arrivent de nombreux rapatriés d’Algérie qui avaient de meilleures situations : commerçants, agriculteurs. Dans les années 70, quelques asiatiques, de milieu aisé. Il y a toujours eu des gitans, mais ils n’allaient jamais jusqu’au brevet, ils s’arrêtaient avant, même quand leurs résultats étaient bons. Ils étaient alors surtout marchands ambulants sur les marchés. Il y a toujours eu dans l’école une majorité de gens du quartier, français d’origine. D’autres venaient des villages en pension. Les vagues successives d’immigration se sont intégrées facilement chez nous, le Maghreb à partir de 1980. L'école est devenue mixte à peu près au même moment. La première année, il y avait un seul garçon pour 400 filles… Les parents ont toujours bien participé à la vie de l’école, aux lotos, kermesses , sorties. L’ambiance était très bonne, et j’ai eu beaucoup de mal à quitter cette école à ma retraite. Un souvenir particulier pour la sœur Saint Marie, directrice émérite.
2- André Llobet
André Llobet habite au n° 100 du Faubourg Figuerolles, à la « Grande Maison ». C’est un chasseur comme on les aime. De ceux qui ont marqué notre enfance, nos souvenirs, qui revenaient de la garrigue avec des odeurs de thym et d’aspic, avec un lièvre ou une paire de perdreaux au fond de leur sac de cuir.
André Llobet : « J’ai commencé à chasser tout petit, avec un lance-pierre. Mon gibier : les lézards, les petits oiseaux. J’en touchais un sur 1000… Ensuite, avec mon père. Comme tous les jeunes, je portais le carnier et en même temps, j’apprenais tout de la chasse. Les règles de sécurité aussi, car nos parents étaient sévères et ne laissaient rien passer. C’était bien plus efficace comme formation que le permis de chasser qui existe aujourd’hui. Rien à voir. Le seul problème, c’est que ça donnait terriblement envie de chasser ; on languissait d’avoir 15 ans. C’était tout un univers. Après la guerre, comme il n’y avait pas de cartouches, on se les fabriquait. On récupérait les vieilles douilles, on les re-calibrait, on faisait tomber des gouttes de plomb fondu dans des bassines d’eau, on refaisait les amorces avec le phosphore des anciennes allumettes, celles qu’on pouvait allumer sur les pantalons. Pour la poudre, les bourres, on se débrouillait aussi. Alliez-vous chasser les canards et les macreuses ? La chasse à l’eau, c’est quelque chose de merveilleux, tout un art immense. C’est la disposition des appelants (gibier domestique) qui fait la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Il faut aussi connaître quelques ruses. Par exemple savoir appeler les macreuses avec une « piute », c’est un appeau.

Et là, seul dans son poste, à 2 ou 300 m des autres chasseurs, on rêve, face au ciel, aux étoiles, à la lune. Au début, la Grande Motte n’existait pas et l’aéroport de Fréjorgues n’éclairait pas beaucoup. La nuit, on n’y voyait pas bien loin. Alors, on mettait au bout du canon du fusil un morceau de chambre à air pour pouvoir viser à peu près. C’était comme une masse qui nous servait de point de mire.
Auriez-vous une ou deux anecdotes à nous raconter ?
« Bien sûr. Je vais d'abord vous raconter une histoire horrible ! Une année, on était parti faire l’ouverture du 14 juillet (à l’époque, c’était autorisé). Il nous fallait partir 3 jours avant pour avoir un poste, on essayait d’avoir le meilleur. On s’engageait sur l’étang sur un négafol (noie le fou en patois), un petit barqué très plat dans lequel on chargeait tout ce qu’il fallait pour trois jours. Mais cette année-là, exceptionnelle, il y avait des milliards de moustiques. Malgré le No-pic, on s’est fait dévorer. On mettait les couvertures sur la tête, rien n’y faisait. Au final, la veille de l’ouverture, on a été obligé de rentrer, tellement on avait de fièvre et de maux de tête. Alliez-vous aussi chasser dans la garrigue ? A terre, à l’époque, il y avait énormément de gibier. Aujourd’hui, il n’y en a plus beaucoup, surtout à cause des produits agricoles qui sont déversés sur le sol et qui ont fait bien plus de dégâts que tous les chasseurs réunis. Par exemple, les désherbants, pesticides tuent les insectes qui fournissaient une ressource de protéines indispensable aux jeunes perdreaux. Il y a aussi les haies et les arbres, lieux de vie de toute une faune, qui ont été supprimés pour permettre d’avoir des étendues plus larges ou bien parce qu’ils faisaient de l’ombre sur quelques souches et en faisaient baisser le rendement. Enfin, et je dirais presque surtout, il y a l’utilisation de la machine à vendanger, qui ne laisse plus un grain de raisin pour les grives ! Mais il ne faut pas oublier que la chasse, ce n’est pas fini. C’est l’occasion de vivre de très près avec l’environnement et de prendre conscience de l’urgence qu’il y a à le protéger. . .
« C’était un jour, à Mireval, où il y a des falaises qui surplombent les vignes. On était monté sur la crête, et il faisait froid, du vent. Un de nos amis était resté en bas, à l’abri du vent, dans un champ. On le surplombait, et on était bien à 400 m de lui. On a décidé de lui faire une farce. On avait de vieilles cartouches toutes gonflées qui ne rentraient plus dans le fusil. C’était l’occasion de les utiliser. On a découpé le carton de la douille. Ce sont des couches un peu comme un mille feuilles. On en a enlevé jusqu’à ce que la cartouche rentre dans le fusil et on en a tiré une pour que les plombs retombent en pluie autour de lui. Il s’est mis à crier : « Malheureux, arrêtez, j’ai pris un plomb ! ». Mais nous, on en a tiré une autre, sûrs qu’on ne pouvait pas lui faire de mal. Là, il s’était mis à l’abri derrière une cabane. Quand on est descendu, il nous a montré : une grappe de plombs l’avait touché en pleine poitrine et il avait un bleu gros comme un pièce de 5 F… Certainement que les vieux plombs s’étaient soudés et c’est comme s’il avait reçu un caillou lancé de 400 m. La preuve qu’il faut toujours faire attention. On aurait pu lui faire très mal. »
« Jadis, on chassait aussi les écureuils. C’est très bon à manger et c’est aussi un prédateur qui n’hésite pas à dévorer les œufs et les oisillons, mais aujourd’hui, il est protégé. Difficile de voir un écureuil pour pouvoir le tirer car il se cache toujours derrière le tronc. Il y a une technique : il faut poser un béret ou sa musette bien en vue d’un côté de l’arbre et se mettre discrètement de l’autre : le sac lui fait peur et il vient du côté où on l’attend. A la grande époque des grives, dans les années 70, on avait le droit d’utiliser de nombreux appeaux, qui comme le miroir aux alouettes, étaient très efficaces. Parmi eux, le mange disque, qui a ensuite été interdit. J’ai acheté un sifflet, et j’ai passé des heures à écouter le disque chez moi jusqu’à ce que je l’imite à la perfection. C’était terrible. Je sifflais, les grives venaient, je tirais, elles revenaient... ».
3- André Lorente
De 1964 à 1993, le véritable permis de conduire de Figuerolles s’obtenait chez André Lorente.
 André Lorente, le propriétaire de l’auto-école Renouvier, avait promis de nous raconter l’histoire de sa vie. Il a bien fait parce que ce n’est vraiment pas banal. C’est qu’il en a réussi des challenges ! Par exemple, celui de faire passer leur permis de conduire aux jeunes du quartier qui ne savaient pratiquement pas lire.
André Lorente, le propriétaire de l’auto-école Renouvier, avait promis de nous raconter l’histoire de sa vie. Il a bien fait parce que ce n’est vraiment pas banal. C’est qu’il en a réussi des challenges ! Par exemple, celui de faire passer leur permis de conduire aux jeunes du quartier qui ne savaient pratiquement pas lire.
« Je suis né le 8 décembre 1931 à Mauguio. En 1958, j’ai trouvé du travail à la Caisse Régionale d’Assurances Maladie du Cours Gambetta. Grâce à cet emploi, j’ai pu avoir un logement à la Cité Gély. Dans le même temps, les évènements graves se succédaient et je militais beaucoup. A ce moment là, j’étais secrétaire départemental des jeunesses communistes, et membre du comité national du parti. Je me souviens d’avoir présenté publiquement le rapport d’activité de la fédération à Béziers, en 1962, aux côtés de Georges Marchais : je tremblais comme une feuille ! Puis, j’ai été gravement malade, j’ai dû arrêter de travailler. Après une longue convalescence, j’ai décidé de changer de cap. J’avais déjà cinq enfants et j’ai passé mon CAP de moniteur d’auto-école. J’ai commencé chez Bouscaren, qui était à l’époque juste en face du magasin Tati. J’y suis resté 2 ou 3 ans. En fait, c’était ça ma voie. J’aurais bien aimé être instituteur aussi.

Je me suis installé dans ce local un peu par hasard. C’est le coiffeur Dominique, au coin de la rue Daru, qui l’avait loué pour y installer son gendre, gendre qui finalement n’est pas venu. Alors le coiffeur m’a proposé ce local et je l’ai loué. La propriétaire, c’était Mme Navas : une figure du quartier, une grande dame qui fumait le cigare ! C’est elle qui avait fait construire l’immeuble où se trouve aujourd’hui la banque.
Cette banque, à l’époque, après avoir été un bar, c’était un pressing. Juste en face, de l’autre côté du plan, il y avait le mécanicien poids-lourds, mon ami Tarrigo…
Ensuite, j ’ai passé une attestation de capacité et je me suis lancé dans une entreprise de transports en commun. J’ai eu jusqu’à trois autobus. J’ai fait passer aussi tous les autres permis : poids lourd, super lourd, bus. Au final, je me retrouvais avec 3 voitures, 3 motos, un autocar, 1 poids lourd 19 tonnes et un véhicule articulé (semi) pour les leçons. J’avais loué une cour à la zone industrielle pour les parquer. Quand j’ai arrêté, mes enfants n’ont pas voulu continuer, car il fallait maintenant s’équiper de cars neufs, avec toilettes, vidéo. C’était trop lourd comme investissement, car en plus, il faut changer les voitures tous les ans. Je n’ai pas réussi à vendre l’auto-école en tant qu’auto-école, parce que c’était le moment où Figuerolles avait sa plus mauvaise réputation et personne ne voulait plus venir s’y installer. De plus, je n’ai jamais voulu que mon affaire devienne une grande auto-école.»
On entend souvent dire du mal de la formation des conducteurs. Qu’en pensez-vous ?
« Vous savez, quand j’entends à la télé des spécialistes, des coureurs automobiles dire que quand on vient d’avoir son permis, on ne sait pas conduire, ça me fait rire. Vous savez, les gens essaient d’avoir leur permis avec le moins de leçons possible. 15 leçons au maximum. C’est vraiment peu. Je veux bien donner une meilleure formation, mais qui va payer ? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Moi, je ne pouvais faire de route avec mes élèves, ils n’en avaient pas les moyens financiers. Alors on faisait au plus serré avec les moyens qu’ils avaient. Dans les auto-écoles, il y a des gens très sérieux qui aiment vraiment leur boulot, on se rencontrait assez souvent. Personne ne peut faire de miracles. D’autant que pour certaines personnes, il faut beaucoup de travail. En général, plus on est âgé, plus c’est difficile. Quelle est la plus grande cause d’échec ? C’est l’émotivité. Il y a des gens qui perdent contrôle, qui n’ont pas assez confiance en eux, que l’inspecteur terrorise. Je me souviens d’un élève qui a dû le passer 12 fois ! Et tous les 4 échecs à la conduite, il devait repasser le code. A la fin, j’ai dit à l’inspecteur que maintenant, ça suffisait, avec toutes les leçons qu’il avait prises. Il le lui a donné. Et après, ce monsieur n’a jamais eu un seul accident de sa vie. Il était même responsable d’un club sportif dans le quartier et par la suite il a transporté régulièrement mes enfants ».
Conduire sans savoir lire ni écrire
André Lorente avait pour mission de permettre à tous d’accéder au fameux papier rose signé par l’inspecteur à la fin de la redoutable épreuve de conduite. Mais avant de pouvoir se présenter à cet examen, il fallait avoir obtenu le code, qui atteste de la connaissance des règles de circulation, des panneaux, etc. Si pour certains, ce premier pas était une formalité, il n’en allait pas de même avec toute une partie de la population du quartier, notamment la communauté gitane, dont bien des jeunes ne savaient quasiment ni lire ni écrire. Il en fallait plus pour décourager notre moniteur. « Avec eux, c’était l’inverse. Ils conduisaient déjà, et mieux que moi. Il fallait que je me fâche pour qu’ils ne se présentent pas à l’examen au volant de leur voiture. Par contre, le vrai problème, c’était le code ». Alors, André Lorente multipliait les leçons : « Je les faisais venir tous les jours, pour leur expliquer tout ça. Il me fallait traduire le langage officiel, sinon ils me traitaient de parisien. Si je parlais d’intersection au lieu de croisement ou si je disais dépasser à la place de doubler ils levaient les bras au ciel : tu es trop compliqué André, parle français, on n’y comprend rien ! » Et tout finissait par un examen oral, et l’obtention du permis. Restait à résoudre le problème du règlement. Pour les gens sans ressources, on pouvait obtenir un financement des ASSEDIC en contrepartie d’une promesse d’embauche.
C’est de cette façon que j’étais payé, sauf quand je ne l’étais pas. En effet, les ASSEDIC versaient en deux fois, une première fois après le code, là j’étais payé, et une deuxième fois après l’obtention de la conduite. C’est à ce moment que je n’en revoyais plus quelques uns. Mais je ne leur en ai jamais voulu. D’abord parce qu’il y en a eu très peu qui m’ont fait ce coup là, et ensuite parce que je comprenais bien qu’ils avaient très peu d’argent et que pour certains, la tentation était trop forte ».
André Lorente nous explique qu’à l’époque, les inspecteurs du permis de conduire étaient tous des retraités de l’armée ou de la gendarmerie, anciens officiers ou sous-officiers. Il était alors interdit à un moniteur d’auto-école de se présenter à ce concours. « On ne peut pas dire qu’ils étaient bien formés à ce métier, contrairement à aujourd’hui », souligne André. Qui ne se souvient des réputations terribles que se forgeaient des inspecteurs célèbres pour leur sévérité. Face à eux, il y avait tout type de réaction. De l’hyper émotif qui restait paralysé au Jean Yanne furieux en passant par celui qui proposait un gros billet… « Il m’est arrivé d’en séparer » se souvient André en souriant. Mais il lui est tout arrivé, en fait, y compris de mettre dehors des inspecteurs qui exagéraient, qui faisaient caler un élève ou signaient le papier rose ou jaune alors que l’élève n’avait fait que 200 mètres au volant, comme de s’attraper avec des élèves insolents. Avec en moyenne 40 par mois, dont beaucoup de femmes (les maris avaient déjà passé leur permis). André s’est régalé de cette vie qu’il a traversé avec droiture, dans un univers qui ne manquait pas de malhonnêtes et de tricheurs. Tout le monde se souvient des affaires qui avaient fait la une des journaux à l’époque. Rien de tout ça à l’école Renouvier, où tout le quartier s’en souvient, il fallait filer droit. Mais à la fin, on repartait avec le permis...
4-Catherine Bascoul
J'ai été institutrice pendant trois ans, de 1993 à 1996, à la maternelle du Docteur Roux, en haut du faubourg Figuerolles.

« J’arrivais de Normandie quand j’ai appris que toute l’équipe des 5 collègues de l ‘école venait de la quitter à la suite de difficultés multiples. J’étais très angoissée devant ce monde inconnu, décrit comme ingérable. J’ai donc vécu trois années difficiles, mais enrichissantes. Difficiles, car il m’a fallu donner beaucoup de moi, passer du temps hors école. On se sentait loin de tout, abandonnés, sans moyens spécifiques. Nous avions un public composé d’enfants gitans et d’enfants issus de la nouvelle population du quartier : artistes, intellectuels, cadres moyens. Les gitans ne venaient pas le matin, sauf une minorité, et l’après-midi, la classe était au complet. Les enfants gitans restaient entre eux. Il n’y avait pas de graves problèmes de discipline, ils étaient contents qu’on s’occupe d’eux, d’être à l’école. Ils étaient très vifs, plein d’élan, agréable en classe. Certains étaient adorables, des petites filles très sages. Mais tout incident pouvait prendre des proportions immenses, et j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de limite à la colère des parents si un enfant avait été blessé. Il falait expliquer tout le temps, et quand la confiance était établie, tout allait bien. Des gens qui parlaient vrai, qui disaient les choses en face, parfois de façon maladroite. Pour moi, ce fut très enrichissant. Pourquoi ne seraient-ils pas dans le vrai quand leur seule inquiétude est le bonheur d’un enfant.
5- Christian Bouillé
Christian Bouillé est un personnage clé à Figuerolles. En effet, il a la responsabilité de la gestion d’un précieux patrimoine culturel. Interview :
 J’ai d’abord été instituteur dans le Gard, pendant 5 ou 6 ans, dans les années soixante. J’étais originaire du Martinet, en plein coeur des Cévennes minières. C’est dans cette région que j’ai commencé à enseigner. Puis, je suis venu à Montpellier en 1967 pour me former à la profession de professeur de collège. J’ai passé le concours des IPES, ce qui permettait à l’époque de continuer ses études tout en étant payé ; mes parents n’étaient pas riches ! J’ai franchi tous les échelons, obtenu mon CAPES, et enfin un premier poste à Montpellier. Quand j’ai réussi mon doctorat, on m’a proposé un poste dans le Gard, mais j’étais devenu trop Montpellierain et j’y suis resté. Je suis devenu professeur à la faculté des Sciences, comme physiologiste spécialisé en neurobiologie. Vous ne vous êtes pas arrêté là ? Non. Dans les années 90, je me suis fortement impliqué en politique, et j’ai été élu dans l’équipe de Georges Frêche. En 98, j’ai été élu comme conseiller général sur le septième canton, que je connaissais bien, car j’avais habité deux ans rue Tour Gayraud, et en 2004, j’y ai été réélu avec plus de 65 pour cent des voix ! Je dispose actuellement d’une importante délégation au Conseil Général, sur les thèmes de l’insertion et de l’emploi. A Montpellier, je m’occupe de la sécurité mais aussi de la politique de la ville, avec des dossiers énormes, comme ceux de la rénovation urbaine (ANRU), qui concernent Figuerolles et la Cité Gély, mais aussi Les Cévennes, Le Petit Bard et la Mosson. Et, au cas où je m’ennuierais, je suis aussi maire adjoint du grand quartier des Cévennes (42 000 habitants). Pour finir, j’occupe le poste de secrétaire de la septième section du parti socialiste de Montpellier, qui compte 300 adhérents et fait partie des trois plus importantes de l’Hérault. Pour la petite histoire, il faut savoir que, quand j’y suis arrivé, en 1993, il n’y avait que 13 personnes ! Nos militants sont là par conviction, bien sûr, mais aussi parce que je m’occupe activement de leurs dossiers personnels quand ils le demandent. Je travaille beaucoup : 70 heures par semaine en tout, 35 heures à la ville, 35 heures au département. J’ai trois secrétaires qui croulent sous les dossiers… Je ne défraie pas la chronique, mais je travaille sans arrêt. Aujourd’hui, j’habite avenue Louis Ravas, mais j’ai habité pendant 20 ans la Cité des Cévennes. Je vois les gens en faisant mes courses ; tout le monde a mon numéro de portable et peut me joindre facilement.
J’ai d’abord été instituteur dans le Gard, pendant 5 ou 6 ans, dans les années soixante. J’étais originaire du Martinet, en plein coeur des Cévennes minières. C’est dans cette région que j’ai commencé à enseigner. Puis, je suis venu à Montpellier en 1967 pour me former à la profession de professeur de collège. J’ai passé le concours des IPES, ce qui permettait à l’époque de continuer ses études tout en étant payé ; mes parents n’étaient pas riches ! J’ai franchi tous les échelons, obtenu mon CAPES, et enfin un premier poste à Montpellier. Quand j’ai réussi mon doctorat, on m’a proposé un poste dans le Gard, mais j’étais devenu trop Montpellierain et j’y suis resté. Je suis devenu professeur à la faculté des Sciences, comme physiologiste spécialisé en neurobiologie. Vous ne vous êtes pas arrêté là ? Non. Dans les années 90, je me suis fortement impliqué en politique, et j’ai été élu dans l’équipe de Georges Frêche. En 98, j’ai été élu comme conseiller général sur le septième canton, que je connaissais bien, car j’avais habité deux ans rue Tour Gayraud, et en 2004, j’y ai été réélu avec plus de 65 pour cent des voix ! Je dispose actuellement d’une importante délégation au Conseil Général, sur les thèmes de l’insertion et de l’emploi. A Montpellier, je m’occupe de la sécurité mais aussi de la politique de la ville, avec des dossiers énormes, comme ceux de la rénovation urbaine (ANRU), qui concernent Figuerolles et la Cité Gély, mais aussi Les Cévennes, Le Petit Bard et la Mosson. Et, au cas où je m’ennuierais, je suis aussi maire adjoint du grand quartier des Cévennes (42 000 habitants). Pour finir, j’occupe le poste de secrétaire de la septième section du parti socialiste de Montpellier, qui compte 300 adhérents et fait partie des trois plus importantes de l’Hérault. Pour la petite histoire, il faut savoir que, quand j’y suis arrivé, en 1993, il n’y avait que 13 personnes ! Nos militants sont là par conviction, bien sûr, mais aussi parce que je m’occupe activement de leurs dossiers personnels quand ils le demandent. Je travaille beaucoup : 70 heures par semaine en tout, 35 heures à la ville, 35 heures au département. J’ai trois secrétaires qui croulent sous les dossiers… Je ne défraie pas la chronique, mais je travaille sans arrêt. Aujourd’hui, j’habite avenue Louis Ravas, mais j’ai habité pendant 20 ans la Cité des Cévennes. Je vois les gens en faisant mes courses ; tout le monde a mon numéro de portable et peut me joindre facilement.
Le quartier Figuerolles commence au plan Cabanes et se termine après la Cité Gély. Pour la Mission Grand Cœur, il fait partie du quartier Centre et de la septième circonscription qui compte 25 000 habitants.. Schématiquement, je dirais qu’à partir du numéro 50, avant le pont, il y a une coupure : au dessus, un monde plutôt gitan, en dessous, plutôt maghrébin. Mais c’est aussi un melting-pot, avec une population bobo (bourgeois bohème, ndlr), artiste, qui se plait dans cette atmosphère décontractée qui caractérise Figuerolles. Dans l’ensemble, un mélange réussi de nombreuses immigrations successives, dans un des quartiers les plus anciens de Montpellier. Au final, aujourd’hui, l’allure d’un village, avec des commerces de qualité. Il y a aussi le côté noir de ce faubourg, non ? On montre souvent du doigt Figuerolles, pour ses trafics, son commerce de drogues dures, pour ces voitures qu’on ne peut expliquer comment leurs jeunes propriétaires on fait pour les acheter. Mais croyez que nous y travaillons. La ville a mis en place un CLSPD, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. La police municipale n’a pas un rôle répressif, mais de prévention. Elle lutte contre les nuisances publiques, les incivilités, le bruit, etc. Nous avons mené une expérimentation sur trois places sensibles de la ville : Candolle, Saint Roch et la Canourgue. Les résultats sont excellents. Nous souhaitons les étendre à toute la ville, avec la présence sur zone de policiers municipaux, de 20h à 4 h du matin, qui appellent la police nationale en cas de besoin ; mais nous avons besoin d’un engagement de l’Etat pour pouvoir continuer. La ville seule ne peut pas tout faire. Contacter Christian Bouillé : 06 12 48 82 86
Christian Bouillé est intarissable. Rénovation, insertion, éducation, formation, il fait feu de tout bois et ne ménage pas sa peine : « La Cité Gély va être complètement réhabilitée, de petites villas seront construites sur le stade qui se trouve derrière. L’objectif commun à tout le quartier est d’arriver à une réelle mixité, qui regroupera logements sociaux et privatifs. Ces opérations passent par des préemptions municipales et des aides à la rénovation, en essayant de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Il s’agit bien de hisser Figuerolles sur la même corde que les autres quartiers, développer la sécurité, le social et la culture en partenariat avec le tissu associatif. »
Il nous signale deux actions phares qui lui tiennent à cœur : « Tout d’abord, dans le cadre de la lutte pour l’emploi nous avons ouvert La Gaminerie à la Cité Gély.
 A partir de la récupération et de la remise en état de vêtements, nous faisons travailler 15 personnes au RMI, avec chaque année une douzaine d’intégrations dans le monde du travail.Il s’agit d’un chantier d’insertion, financé chaque année à hauteur de 70 000 euros par la DES (Direction de l’Economie Sociale) et 120 000 euros par le FSE (Fonds Social Européen). Nous envisageons un développement dans le secteur de la mécanique. »
A partir de la récupération et de la remise en état de vêtements, nous faisons travailler 15 personnes au RMI, avec chaque année une douzaine d’intégrations dans le monde du travail.Il s’agit d’un chantier d’insertion, financé chaque année à hauteur de 70 000 euros par la DES (Direction de l’Economie Sociale) et 120 000 euros par le FSE (Fonds Social Européen). Nous envisageons un développement dans le secteur de la mécanique. »
 « L’autre action vedette, c’est la Chapelle, que nous avons progressivement équipée, mise aux normes de sécurité, et qui, dans le futur écrin que sera la Cité Gély, sera un véritable bijou. Etienne Scwarcz y fait un travail remarquable depuis 2001. Il y développe de nombreuses activités artistiques telle que la diffusion, la résidence d’artistes, la recherche et la création. Il tisse des liens privilégiés avec les habitants du quartier mais également avec le public de la région. Une idée sous tend cette relation : le brassage de population avec le moteur artistique comme moyen de transcender les clivages. »
« L’autre action vedette, c’est la Chapelle, que nous avons progressivement équipée, mise aux normes de sécurité, et qui, dans le futur écrin que sera la Cité Gély, sera un véritable bijou. Etienne Scwarcz y fait un travail remarquable depuis 2001. Il y développe de nombreuses activités artistiques telle que la diffusion, la résidence d’artistes, la recherche et la création. Il tisse des liens privilégiés avec les habitants du quartier mais également avec le public de la région. Une idée sous tend cette relation : le brassage de population avec le moteur artistique comme moyen de transcender les clivages. »
6- Christian Laborde
Christian Laborde est le propriétaire de la droguerie « Couleurs du Midi », place Salengro. Spécialité qui se raréfie dans les villes. Pourtant, on trouve là des choses surprenantes. Présentation
 Christian Laborde, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Je suis né en 1954, à Paris. J’en ai toujours gardé l’accent, d’ailleurs . Je me suis installé dans ce quartier en 1985. A l’époque, nous étions plusieurs droguistes sur Montpellier. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux. Que s’est-il passé ? La clientèle est toujours là, mais elle s’est disséminée dans les grandes et moyennes surfaces. Il y en a dans toutes les zones commerciales. La concurrence a été terrible. Comme je bénéficie des caractéristiques un peu spéciales de ce quartier, je me suis spécialisé dans des produits très spécifiques comme la chaux ou les pigments. C’est comme ça que j’ai pu tirer mon épingle du jeu et jouer sur une clientèle qui m’est devenue très fidèle. Qu’est-ce qui vous permet de dire cela ? C’est que j’ai affaire à des gens qui viennent très souvent, me téléphonent régulièrement pour des conseils. Un journal local m’avait appelé le « Roi du Conseil » ! C’est vrai qu’on trouve chez moi des produits pas courants et que je peux vous expliquer comment on s’en sert. Je récupère même des clients de grandes surfaces qui ne savent pas utiliser ce qu’ils y ont acheté. Bien sûr, je commence par les taquiner : « Allez leur demander comment il faut faire, pour voir ! ». Puis après je leur explique tout… C’est vraiment ma force, le conseil. D’où vous vient cette compétence ? C’est que je suis dans le métier depuis 25 ans, je tourne beaucoup, je vais sur tous les chantiers, je travaille avec de nombreux artisans. J’ai commencé ma carrière comme représentant d’une marque de peinture, c’est vous dire si toute ma vie professionnelle s’est articulée autour de ce métier. Pourtant, force est de constater que des magasins comme le mien sont condamnés à moyenne échéance. Je fais en sorte de proposer une gamme très étendue de produits pour répondre à toutes les demandes des bricoleurs et des personnes âgées qui viennent chez moi : droguerie, peinture, électricité, plomberie. Je suis un des seuls chez qui les artisans et les artisans d’art trouvent les produits rares dont ils ont besoin. Vous pouvez nous en citer ? Par exemple, je suis un spécialiste de la chaux aérienne pour la décoration intérieure ainsi que de tous les pigments et la poudre de marbre qui servent à réaliser les enduits du type stuc et tadelack. Même chose en ce qui concerne les métaux, l’argenterie ou encore le bois : je dispose de tous les types de cire pour antiquaires et ébénistes, de la fameuse cire de carnauba, de tous les genres de pâte à bois, de décapants. Je peux tout vous fournir, la cire à reboucher, le vernis bistrot, la crème à dorer, la dorure antiquaire, la teinture pour tissus, la cire à patiner, la dorure à la cire ou au vernis et plus si affinités… Comment vous sentez-vous à Figuerolles ? Dans ce quartier, je suis très à l’aise. D’ailleurs, depuis quelques années, il a une bien meilleure réputation. C’est un lieu très commerçant, on y trouve de tout. De plus, il se modernise sans cesse et prend de la valeur. La rénovation de la place Salengro commence ce lundi et va durer plus d’un mois. Cette place est très connue dans toute la ville, même si les gens font parfois la confusion entre le Plan Cabanes et la Place Salengro. J’ai des clientes que je connais depuis des années, qui me prennent toujours les mêmes produits. Si par hasard je ne l’ai pas ou si on ne le fabrique plus, c’est la crise !
Christian Laborde, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Je suis né en 1954, à Paris. J’en ai toujours gardé l’accent, d’ailleurs . Je me suis installé dans ce quartier en 1985. A l’époque, nous étions plusieurs droguistes sur Montpellier. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux. Que s’est-il passé ? La clientèle est toujours là, mais elle s’est disséminée dans les grandes et moyennes surfaces. Il y en a dans toutes les zones commerciales. La concurrence a été terrible. Comme je bénéficie des caractéristiques un peu spéciales de ce quartier, je me suis spécialisé dans des produits très spécifiques comme la chaux ou les pigments. C’est comme ça que j’ai pu tirer mon épingle du jeu et jouer sur une clientèle qui m’est devenue très fidèle. Qu’est-ce qui vous permet de dire cela ? C’est que j’ai affaire à des gens qui viennent très souvent, me téléphonent régulièrement pour des conseils. Un journal local m’avait appelé le « Roi du Conseil » ! C’est vrai qu’on trouve chez moi des produits pas courants et que je peux vous expliquer comment on s’en sert. Je récupère même des clients de grandes surfaces qui ne savent pas utiliser ce qu’ils y ont acheté. Bien sûr, je commence par les taquiner : « Allez leur demander comment il faut faire, pour voir ! ». Puis après je leur explique tout… C’est vraiment ma force, le conseil. D’où vous vient cette compétence ? C’est que je suis dans le métier depuis 25 ans, je tourne beaucoup, je vais sur tous les chantiers, je travaille avec de nombreux artisans. J’ai commencé ma carrière comme représentant d’une marque de peinture, c’est vous dire si toute ma vie professionnelle s’est articulée autour de ce métier. Pourtant, force est de constater que des magasins comme le mien sont condamnés à moyenne échéance. Je fais en sorte de proposer une gamme très étendue de produits pour répondre à toutes les demandes des bricoleurs et des personnes âgées qui viennent chez moi : droguerie, peinture, électricité, plomberie. Je suis un des seuls chez qui les artisans et les artisans d’art trouvent les produits rares dont ils ont besoin. Vous pouvez nous en citer ? Par exemple, je suis un spécialiste de la chaux aérienne pour la décoration intérieure ainsi que de tous les pigments et la poudre de marbre qui servent à réaliser les enduits du type stuc et tadelack. Même chose en ce qui concerne les métaux, l’argenterie ou encore le bois : je dispose de tous les types de cire pour antiquaires et ébénistes, de la fameuse cire de carnauba, de tous les genres de pâte à bois, de décapants. Je peux tout vous fournir, la cire à reboucher, le vernis bistrot, la crème à dorer, la dorure antiquaire, la teinture pour tissus, la cire à patiner, la dorure à la cire ou au vernis et plus si affinités… Comment vous sentez-vous à Figuerolles ? Dans ce quartier, je suis très à l’aise. D’ailleurs, depuis quelques années, il a une bien meilleure réputation. C’est un lieu très commerçant, on y trouve de tout. De plus, il se modernise sans cesse et prend de la valeur. La rénovation de la place Salengro commence ce lundi et va durer plus d’un mois. Cette place est très connue dans toute la ville, même si les gens font parfois la confusion entre le Plan Cabanes et la Place Salengro. J’ai des clientes que je connais depuis des années, qui me prennent toujours les mêmes produits. Si par hasard je ne l’ai pas ou si on ne le fabrique plus, c’est la crise !

Alors, selon vous, qu’est ce qui est spécial ici ? La force de ce quartier, c’est cette clientèle spécifique de gens qui ont leurs habitudes, qui ne vont quasiment jamais dans les grandes surfaces, qui préfèrent profiter de ces lieux de vie et qui finalement sont gagnants car ils n’achètent que vraiment ce qu’il leur faut, en économisant les frais de transport. En plus, ici il y a des horaires d’ouverture comme nulle part ailleurs, venez essayer… Et puis la vie associative y est très forte. Même si je n’ai pas beaucoup le temps d’y participer, ce que font la Maison Pour Tous Joseph Ricome et l’association Drôle de Figue, c’est formidable. Entre commerçants, ici, on s’entend très bien. On est tous copains, il y a une très bonne entente et une grande solidarité. Le marché sur la place développe petit à petit une nouvelle clientèle : on voit arriver de nouvelles têtes…
Contact : Couleurs du Midi, 16 place Roger Salengro, 34000 Montpellier.
Tel/fax : 04 67 92 17 43
7- Claire et Thierry
S’il est un étal célèbre sur le marché de la place Salengro, c’est bien celui de Claire et Thierry. Il nous fallait en savoir plus sur cette légende vivante. Rencontre.

Claire Almés, depuis quand êtes vous sur ces lieux ?
« On a repris la suite de mes parents il y a 23 ans. Ils étaient installés au Plan Cabanes, où ils étaient arrivés dans les années 50. A ce moment-là, ils vendaient du miel qu’ils allaient chercher dans l’Aveyron. Puis, ils ont eu l’idée d’aller en Provence pour y acheter les fruits de saison (melons, cerises, pommes, poires). Ils les vendaient alors par deux ou trois kilos, et ça marchait très bien. Par exemple, une fois, au moment des cerises, ils en avaient ramené 9 variétés et en on vendu 900 kilos dans la
matinée ! C’était la vente d’autrefois, mais on n’avait que les produits de saison, de mars à septembre, et il fallait avoir gagné là de quoi vivre toute l’année.
Qui était en place au Plan Cabanes, à l’époque, dans votre « branche » ? « Autrefois, avec nous, il y avait 4 jardiniers. C’étaient M. Cambon, Mme Giner, M. Galibert et M. Jonquet. Quand on a repris, on s’est rendu compte qu’il fallait diversifier, continuer l’hiver. On s’est alors tourné vers le marché-gare pour les produits espagnols qu’on ne trouvait pas en Provence. Et peu à peu, tous nos jardiniers sont partis à la retraite. Enfin, il y a 15 à 18 ans, sont arrivés les maghrébins pour les remplacer. Eux ont une clientèle de familles nombreuses qui recherche les prix les plus bas. Ils achètent essentiellement au marché gare tout ce qui a été invendu, en jouant sur la quantité.
On achète au maximum aux jardiniers qui existent encore, à Mauguio, à Lattes, à Candillargues, à Lansargues : de petits producteurs, qui offrent une belle qualité. Ils font attention à ce qu’ils plantent et traitent le moins possible. Cela n’a rien à voir avec les productions intensives sous serre, qui viennent surtout d’Espagne, un peu d’Italie, et progressivement, depuis une dizaine d’années, de Belgique et de Hollande. En Belgique, on a distribué d’énormes subventions pour réaliser des cultures sous serres chauffées : le résultat, de très beaux produits, mais qui n’ont aucun goût… On vend aussi du bio, bien sûr, avec un ou deux producteurs réguliers, mais aussi avec d’autres au coup par coup : quand je les vois proposer quelque chose qui me plait, au marché-gare, je le prends. Il y a une forte demande. Les gens veulent des produits non traités, même s’ils sont moins jolis d’aspect, pour peu qu’ils aient du goût. Regardez mes mirabelles et goûtez moi ça : c’est un papy qui me les descend de l’Aveyron en 403 ! Nos clients nous font confiance : ils nous demandent notre avis avant d’acheter. C’est la différence avec les grandes surfaces.
Les nouvelles variétés, mises au point par les chercheurs, sont surtout destinées à la grande distribution, avec des critères d’aspect et de longue conservation au détriment du goût, avec plus ou moins de résultats. Il a été par exemple proposé un nouveau type de melon, croisé avec de la courgette. Au goût, on retrouvait son arrière goût de courgette, et à la conservation, ces melons s’abîmaient, se couvraient de tâches. Ils sont quand même partis à bas prix dans les hypermarchés. Un meilleur exemple, c’est la prune Sun. Un croisement qui donne un très bon goût pour un fruit qui se conserve une éternité.
 Un vrai sujet, c’est la tomate : c’est avec elle que l’on fait vraiment la différence et les gens sont fins connaisseurs, ils nous prennent en priorité la cœur de boeuf et la tomate russe. Une tomate molle est plus goûteuse, plus savoureuse que les variétés plus fermes, qui intéressent davantage les grandes surfaces car elles se conservent mieux, comme la Long life. La tomate grappe, quoique moyenne en goût, est régulière toute l’année.
Un vrai sujet, c’est la tomate : c’est avec elle que l’on fait vraiment la différence et les gens sont fins connaisseurs, ils nous prennent en priorité la cœur de boeuf et la tomate russe. Une tomate molle est plus goûteuse, plus savoureuse que les variétés plus fermes, qui intéressent davantage les grandes surfaces car elles se conservent mieux, comme la Long life. La tomate grappe, quoique moyenne en goût, est régulière toute l’année.
Notre clientèle est très attentive à tout ça et a bien évolué. On voit beaucoup de jeunes qui achètent peut-être moins qu’avant mais qui cherchent des produits frais. Près de la moitié de nos acheteurs est composée d’habitués, que l’on voit tous les jours et qui venaient déjà chez nos parents, ils savent ce qui est bon. Beaucoup sont de par là, n’ont pas de voiture ou ne la sortent jamais. D’autre viennent de plus loin : ce sont des gens qui ont repéré quelques vendeurs de qualité et font leur tournée : fruits et légumes, poissons, boucherie, charcuterie, fromage en plusieurs endroits de la ville. Avec eux, on échange des adresses
.Transfert du marché de Cabanes à Salengro
Si, au moment du transfert de ce marché, des voix virulentes s’étaient élevées, on semble aujourd’hui satisfait de ce changement. Pour Claire et Thierry, c’est clair, ils travaillent plus ici, dans une ambiance plus conviviale, de mieux en mieux organisée (marquage des emplacements, stabilisation du sol, électricité, nettoyage). Il devient difficile aujourd’hui de trouver un opposant. De nombreux habitants du quartier expriment leur satisfaction devant la présence de ce lieu d’échanges et de rencontres. Thierry Almés nous explique : « Du Plan Cabanes, tous les abonnés ont récupéré leur place. Les seuls grands perdants, ce sont les vendeurs sauvages, qui ne peuvent plus déballer. Ils sont partis en un premier temps à la Paillade, mais sont progressivement contraints de se déclarer. Le marché est maintenant mieux organisé, les gens du faubourg y viennent nombreux, n’ont plus peur de se faire écraser par les bus en traversant le cours Gambetta, et apprécient vraiment cet endroit ombragé et accessible ». C’est vrai qu’il existe une dynamique économique qui semblerait profiter aux commerces de la place. Si beaucoup moins de clientèle descend du Petit Bard ou de la Paillade, c’est parce que, selon Thierry, de nombreux commerces s’y sont ouverts et le voyage à Figuerolles devient inutile. La mobilisation des habitants semble donc suffisante pour faire vivre cet espace à la dimension de ses résidents, qui sembleraient aujourd’hui s’y sentir bien à l’aise. Ce serait donc un lieu de mixité et d’intégration qui se recréerait là.

En tout cas il est plus facile d’y aller que d’en revenir : on y rencontre toujours quelqu’un qu’on connaît ou qui a quelque chose à dire. Quand aux futurs marchés attendus Plan Cabanes, ils sont reçus plutôt favorablement : l’occasion de dynamiser un peu les commerces du Courreau et du Plan, qui ont certes souffert de l’arrêt du marché.
8- Georges Doumenc
Georges Doumenc est né le 7 octobre 1925 à Montpellier. D’abord journaliste à « La Voix de la Patrie », il a ensuite travaillé à « La Marseillaise » jusqu’en 1981. Originaire du quartier de Figuerolles à Montpellier, il a suivi en 1947 la mise en place de la fameuse Commune Libre et nous donne de précieuses indications.
 Au lendemain de la libération, il existait une importante cellule du parti communiste à Figuerolles, qui comptait jusqu’à 100 adhérents. Il y a eu aussi pour la Commune Libre l’appui d’une grande figure du parti communiste dans l’Hérault, l’instituteur et député Raoul Callas, qui a joué un rôle d’impulsion, aidé par des familles très actives, comme les Vincelot , les Roucoules, les Niel, les Sablier et René Vieux (boucher dans le faubourg). Beaucoup d’anciens résistants dont certains avaient été déportés se sont investis aussi. .
Au lendemain de la libération, il existait une importante cellule du parti communiste à Figuerolles, qui comptait jusqu’à 100 adhérents. Il y a eu aussi pour la Commune Libre l’appui d’une grande figure du parti communiste dans l’Hérault, l’instituteur et député Raoul Callas, qui a joué un rôle d’impulsion, aidé par des familles très actives, comme les Vincelot , les Roucoules, les Niel, les Sablier et René Vieux (boucher dans le faubourg). Beaucoup d’anciens résistants dont certains avaient été déportés se sont investis aussi. .
A Figuerolles, on avait créé un groupe de jeunes, les Vaillants. C’était une époque où on était très anticléricaux, et quand nos Vaillants passaient devant le patronage du Père Blanc, un jésuite anticommuniste, (le patronage existe toujours et s’appelle aujourd’hui la maisonnée St Joseph), ils chantaient. « Dans une citrouille, il y avait un père Blanc, qui avait la trouille des petits vaillants » !
La Commune Libre était essentiellement composée de militants du PC. Étienne Boute, communiste lui aussi, était conseiller municipal de Figuerolles à la mairie. Il habitait au début de la rue Haguenot. Figuerolles était mieux intégré dans la ville que Boutonnet, qui en était coupé par le Verdanson. De plus, par son architecture, il favorisait l’intégration des populations gitanes et immigrées. Mais on ne rigolait pas entre jeunes de quartiers différents. Boutonnet, le village viticole qui sentait le vin, les Abattoirs, quartier ouvrier, les Barques et Celleneuve avaient chacun leur bande, et de temps en temps, on se rencontrait.
Manitas de Plata participait aux fêtes du PC qu’on organisait au parc Rimbaud. Figurez-vous qu’un jour, alors qu’il jouait aux Stes Maries de la Mer, un individu lui dit « C’est bien ce que vous jouez, est-ce que je peux vous enregistrer ? » Il accepte, flatté. Mais quelques temps plus tard, il trouve au magasin Radelec qui était place Jean Jaurès, un disque Vogue intitulé : Fête gitane aux Stes Maries de la Mer. C’était son enregistrement. Il est venu nous voir et on a publié un article qui a fait beaucoup de bruit, puis il y a eu un procès et Manitas a eu gain de cause. On peut dire que la Marseillaise a bien aidé à son lancement.
Au début, le journal La Marseillaise appartenait au Front National des Bouches du Rhône, qui était un organisme mis en place par le PC et d’autres républicains issus de la résistance. Dans l’Hérault, le journal, créé à la libération, s’appelait La Voix de la Patrie. La rédaction se trouvait rue Henri Guinier. Jusqu’à sa disparition en 1953 ce journal était très lu dans le faubourg Figuerolles. Il sera remplacé par La Marseillaise le 13 février de la même année. Mais c’était un journal un peu éloigné qui connaîtra de nombreuses difficultés jusqu’à ce que Sylvain Jambon et son équipe lancent en 1999 une édition locale, l’Hérault du Jour, moins étroite, plus proche, qui regagnera son lectorat.

Georges Doumenc, ancien résistant et maquisard FTPF du maquis du Vernazoubre, journaliste communiste (A La Voix de la Patrie de 1947 à 1953 ; puis à la Marseillaise à Montpellier et Avignon de 1953 à 1981), ancien responsable du PCF à Montpellier et dans le Département de l'Hérault, est décédé mercredi 20 février 2019 dans sa 94e année.
Ses obsèques auront lieu mercredi 27 février à 15h au centre funéraire de Grammont (Montpellier).
Le journal la Marseillaise adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.
9- Germaine Gispert
« Figuerolles était notre fief »
 Germaine Gispert est née en 1921. Elle quitte Perpignan et arrive à Montpellier en 1951, pour suivre son mari, un ancien déporté qui doit, en raison des graves séquelles dues à sa détention, regagner le centre de rééducation installé jadis au Lycée Joffre. Germaine Gispert habitait alors rue d’Alger, mais elle va orienter toute son énergie à une formidable action en faveur des enfants du faubourg Figuerolles : Les Vaillants… Récit.
Germaine Gispert est née en 1921. Elle quitte Perpignan et arrive à Montpellier en 1951, pour suivre son mari, un ancien déporté qui doit, en raison des graves séquelles dues à sa détention, regagner le centre de rééducation installé jadis au Lycée Joffre. Germaine Gispert habitait alors rue d’Alger, mais elle va orienter toute son énergie à une formidable action en faveur des enfants du faubourg Figuerolles : Les Vaillants… Récit.
« Figuerolles, comme Candolle, était un quartier populaire, où se trouvaient de nombreuses forces de gauche ; des gens qui militaient déjà au sein de cellules d’entreprises mais aussi dans leur quartier. Notamment dans le haut du faubourg, où il y avait beaucoup de déportés, d’anciens résistants. Je pense à Lise Boudou, parce qu’on se réunissait chez elle, à la Grande Maison (HBM) ; il y avait les Niel, les Nadal, le célèbre Mazet. On avait monté un groupe solide. C’était un quartier familier, fraternel.
Jeanne Niel habitait le coeur du quartier au milieu du faubourg ; elle avait 5 enfants, c'était le début des machines à laver (une véritable révolution pour les femmes!). Les allocations familiales accordaient des prêts avantageux aux familles nombreuses. Jeanne en acheta donc une (une petite Hoover). Et que croyez vous qu'il se passa? De nombreux voisins et camarades la lui empruntèrent souvent. J'habitais la rue d'Alger. Tous les lundis, mon jour de congé, j'utilisais la carriole du droguiste et allais chercher la machine. Le matin je faisais mes lessives et ensuite je la portais chez une autre camarade qui s'en servait l'après -midi et faisait en sens inverse le chemin du matin.
C'était la solidarité ! Quelque fois Jeanne ne savait plus où se trouvait sa machine mais elle lui revenait et Jeanne avait toujours le sourire dont les anciens doivent se souvenir.Est-ce notre manège qui donna l'idée à un gars du quartier d'organiser la location ? Sans doute. C'est ainsi qu'après le départ à Paris des Niel nous pûmes continuer de laver à la machine (en payant bien sûr) en attendant d'en acquérir une. Bien des années après, j'ai eu des nouvelles de la machine qui était partie jusqu’à Paris pour finir sa course dans un bungalow à Carnon.
 J’ai commencé à m’occuper de mon petit groupe en 1953. Je n’étais pas la seule ; en tout, sur Montpellier, on accueillait 200 enfants de 6 à 16 ans. On s’en occupait le jeudi et le week-end. On les faisait jouer, danser, on participait au carnaval, on organisait des défilés, mais aussi on discutait beaucoup afin qu’ils puissent, plus grands, continuer une vie militante avec les Pionniers et ensuite les Jeunesses Communistes. On allait souvent au stade Sabathé, et le week-end, on partait faire de la spéléo, ramasser des fossiles, coucher sous la tente. On circulait en vélo ; mon mari était devant en mobylette, avec ma fille derrière lui sur un siège, et moi tout derrière, en mobylette aussi (des ronsonettes) avec mon fils sur le porte bagage. On était tous bénévoles, et financièrement, on se débrouillait avec une petite adhésion et des aides de la caisse d’allocations familiales qui achetait le matériel (tentes, ballons, etc.). On avait aussi nos financements propres (kermesses, tombolas), et tout le monde participait en apportant ce qu’il pouvait… On était tous fauchés mais ce n’était pas grave, on se débrouillait. Tout ça a duré jusqu’au début des années 60, après tout a changé…
J’ai commencé à m’occuper de mon petit groupe en 1953. Je n’étais pas la seule ; en tout, sur Montpellier, on accueillait 200 enfants de 6 à 16 ans. On s’en occupait le jeudi et le week-end. On les faisait jouer, danser, on participait au carnaval, on organisait des défilés, mais aussi on discutait beaucoup afin qu’ils puissent, plus grands, continuer une vie militante avec les Pionniers et ensuite les Jeunesses Communistes. On allait souvent au stade Sabathé, et le week-end, on partait faire de la spéléo, ramasser des fossiles, coucher sous la tente. On circulait en vélo ; mon mari était devant en mobylette, avec ma fille derrière lui sur un siège, et moi tout derrière, en mobylette aussi (des ronsonettes) avec mon fils sur le porte bagage. On était tous bénévoles, et financièrement, on se débrouillait avec une petite adhésion et des aides de la caisse d’allocations familiales qui achetait le matériel (tentes, ballons, etc.). On avait aussi nos financements propres (kermesses, tombolas), et tout le monde participait en apportant ce qu’il pouvait… On était tous fauchés mais ce n’était pas grave, on se débrouillait. Tout ça a duré jusqu’au début des années 60, après tout a changé…
 Ma vie, vous savez, c’est toute une histoire, avec beaucoup de souvenirs, depuis les grandes grèves du bâtiment, en 52, où on collectait des fonds pour soutenir les grévistes ; de ces moments où on vendait le journal Femmes Françaises, les jolis foulards bleus bordés de rouge et les fanions des Vaillants. Je me souviens aussi, après la construction de la cité Gély, quand on allait y vendre le muguet : c’est là qu’on en vendait le plus ! Figuerolles était notre fief, un lieu phare. On s’y battait sur tous les fronts ; pour les crèches, les allocations familiales, la paix. On était un mouvement féministe, mais qui dans son ensemble, avait pris du retard sur l’évolution de la société. 1968 fut une époque difficile à traverser pour nous ; les thèmes liés à l’avortement, à la liberté sexuelle, ont donné lieu à de grands débats internes. Mais depuis, on a rattrapé le retard. En conclusion, je vous dirais que ces années passionnantes et exaltantes ont été une des plus belles périodes de ma vie».
Ma vie, vous savez, c’est toute une histoire, avec beaucoup de souvenirs, depuis les grandes grèves du bâtiment, en 52, où on collectait des fonds pour soutenir les grévistes ; de ces moments où on vendait le journal Femmes Françaises, les jolis foulards bleus bordés de rouge et les fanions des Vaillants. Je me souviens aussi, après la construction de la cité Gély, quand on allait y vendre le muguet : c’est là qu’on en vendait le plus ! Figuerolles était notre fief, un lieu phare. On s’y battait sur tous les fronts ; pour les crèches, les allocations familiales, la paix. On était un mouvement féministe, mais qui dans son ensemble, avait pris du retard sur l’évolution de la société. 1968 fut une époque difficile à traverser pour nous ; les thèmes liés à l’avortement, à la liberté sexuelle, ont donné lieu à de grands débats internes. Mais depuis, on a rattrapé le retard. En conclusion, je vous dirais que ces années passionnantes et exaltantes ont été une des plus belles périodes de ma vie».
10- Hamid Jarmouni
 « Je travaille depuis 14 ans sans avoir jamais pris un jour de repos. Et 18 h par jour ! Je ferme à minuit et j’ouvre à 6 heures du matin. Mon médecin m’a dit de ralentir. Maintenant, j’ai 4 employés, mais avec ma femme, on fait le travail de trois personnes chacun. Parfois, je ne vois pas mon fils pendant un mois, pourtant, il est là . C’est que, pour réussir face aux supermarchés, il faut travailler bien plus que 35 h, faire des gestes commerciaux »
« Je travaille depuis 14 ans sans avoir jamais pris un jour de repos. Et 18 h par jour ! Je ferme à minuit et j’ouvre à 6 heures du matin. Mon médecin m’a dit de ralentir. Maintenant, j’ai 4 employés, mais avec ma femme, on fait le travail de trois personnes chacun. Parfois, je ne vois pas mon fils pendant un mois, pourtant, il est là . C’est que, pour réussir face aux supermarchés, il faut travailler bien plus que 35 h, faire des gestes commerciaux »
.J’ai commencé à travailler 6 mois dans une boucherie, et j’y ai appris le métier. La boulangerie, qui est en face appartenait à une chaîne de 400 magasins en France. Ils n’ont pas su s’adapter au quartier et j’ai pu la leur racheter. J’ai alors embauché pour une courte période un boulanger qui m’a tout appris. J’ai bien modernisé. J’ai une clientèle très variée, propre au quartier. Je vends de la viande Halal, mais aussi du porc et de l’alcool, même si je n’en consomme pas. Je ne mélange pas la religion et le travail. En France, il faut s’intégrer, être diplomate et psychologue. Pour s’intégrer, pour s’accepter mutuellement, il ne faut pas attendre l’intervention de l’Etat. Les lois ne peuvent rien contre le racisme. Il faut se connaître, se rencontrer. Par exemple, quand j’ai voulu louer un appartement, dans la cité où j’habite, les autres locataires ont fait une pétition contre moi. Puis, on s’est rencontré, et quand mon fils est né, tout le monde est venu lui porter un cadeau. Ils m’ont fait des excuses. Et il n’y a plus eu de problème. On s’entend tous très bien. »
11- Hippolyte Annex
 A Figuerolles, Hippolyte Annex est une légende vivante. Ses incroyables succès en boxe anglaise ont profondément marqué le quartier, où, après Auguste Caulet et Léon Capman, il va être l’idole de toute une jeunesse et faire rêver les filles du quartier. Il connaîtra une carrière fulgurante, faite de K.O successifs, de victoires triomphales. Un boxeur qui frappe des deux mains, dur, vite. Bon styliste, clairvoyant et très sec puncheur, il prend les coups sans broncher et possède du battant. Un jeu reconnu à l’époque comme lié, ordonné et sans faiblesses. Insaisissable et fier, on ira jusqu’à dire de lui que dans le ring, c’est Satan sorti de l’enfer. Mais un Satan raffiné, qui sait allier l’intelligence à l’efficacité. En boxe, il deviendra vite « l’homme à éviter »… Hyppolite Annex nous fait ici un grand cadeau, celui de ses souvenirs, de ses photos, d’une mémoire précieuse, qu’il fallait absolument recueillir. Merci , Polyte…
A Figuerolles, Hippolyte Annex est une légende vivante. Ses incroyables succès en boxe anglaise ont profondément marqué le quartier, où, après Auguste Caulet et Léon Capman, il va être l’idole de toute une jeunesse et faire rêver les filles du quartier. Il connaîtra une carrière fulgurante, faite de K.O successifs, de victoires triomphales. Un boxeur qui frappe des deux mains, dur, vite. Bon styliste, clairvoyant et très sec puncheur, il prend les coups sans broncher et possède du battant. Un jeu reconnu à l’époque comme lié, ordonné et sans faiblesses. Insaisissable et fier, on ira jusqu’à dire de lui que dans le ring, c’est Satan sorti de l’enfer. Mais un Satan raffiné, qui sait allier l’intelligence à l’efficacité. En boxe, il deviendra vite « l’homme à éviter »… Hyppolite Annex nous fait ici un grand cadeau, celui de ses souvenirs, de ses photos, d’une mémoire précieuse, qu’il fallait absolument recueillir. Merci , Polyte…
« Je suis né le 14 juillet 1933 à Pézenas. C’est là-bas que j’ai commencé à boxer, au club athlétique Piscénois, en 1951. Ensuite, comme mon oncle, Antoine Poubil, que tout le monde connaissait sous le nom de Lapin, avait une maison rue Saint Antoine à Figuerolles, je me suis installé là. Puis, en 1952, j’ai rejoint l’équipe Léon Capman dans le quartier. Mais en 1953, alors qu’on partait boxer dans une 203 conduite par M. Vasta, son propriétaire, avec Jean Farré, M. Mességuer, Léon Capman et moi même, on a eu un terrible accident sur l’Avenue de la Croix d’Argent. La voiture est entrée en collision avec l’arrière d’un camion. Léon Capman est mort sur le coup. Nous, on a tous été plus ou moins blessés. J’ai du rester un mois à l’hôpital.
C’est un sport très physique. A l’époque, je m’entraînais tous les jours : 10 kilomètres de footing le matin, et l’après midi, en salle, je sautais à la corde, je travaillais au sac, je faisais de la culture physique puis je tirais 7 à 10 rounds avec ceux qui voulaient bien. C’est quelque chose de fantastique, la boxe. C’est droit, c’est honnête, c’est impitoyable. Pour réussir, pour être bien dans sa peau, pendant cinq ans au moins, il faut être sur la ligne, ne pas broncher. C’est à la salle que l’on gagne le combat ! Je n’ai pas de mauvais souvenirs de ma carrière de boxeur, même si j’ai plusieurs fois été blessé aux arcades : c’est très mauvais parce qu’on n’y voit plus rien et l’arbitre arrête le combat, comme ça m’était arrivé contre Papp. Lui, il m’avait touché à l’œil, ça fait le même effet. J’ai dû arrêter. Mais malgré ça, ça reste un des meilleurs souvenirs de ma carrière. J’ai manqué le titre de peu. C’était un très beau combat. Regardez cet article, il en parle.
Et Hippolyte Annex nous lit une coupure de journal qu ‘il a précieusement conservée :
 Le 19 novembre 1962, ce fut la grande aventure du championnat d’Europe. En face c’était Lazzlo Papp, terrible, invaincu, probablement un des plus grands pugilistes de tous les temps. Et Annex menait aux points (c’était du délire dans la salle) quand soudain, au neuvième round, une droite vrillée sortait de la garde du hongrois. Comme Christensen, comme Aridge, comme Mueller, comme Folledo et comme tant d’autres, Polyte s’abattait sur le feutre du ring.
Le 19 novembre 1962, ce fut la grande aventure du championnat d’Europe. En face c’était Lazzlo Papp, terrible, invaincu, probablement un des plus grands pugilistes de tous les temps. Et Annex menait aux points (c’était du délire dans la salle) quand soudain, au neuvième round, une droite vrillée sortait de la garde du hongrois. Comme Christensen, comme Aridge, comme Mueller, comme Folledo et comme tant d’autres, Polyte s’abattait sur le feutre du ring.
A l’évocation de ces souvenirs, celui que l’on appelait le Bombardier gitan a un geste fataliste : C’est évident, ce jour-là je suis passé à côté de quelque chose, mais je n’ai rien à regretter. Grâce à la boxe, j’ai vécu des moments merveilleux. J’ai connu l’Argentine, les USA, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique. J’ai participé au Golden Gloves (championnat de boxe amateur aux USA), j’ai effectué une quinzaine de combats internationaux avec le bataillon de Joinville, où j’ai rencontré des gens comme Kopa, Fontaine, Ujlaki (footballeur aussi) et Anquetil, le célèbre… »
12- Jo l'Oranais
 Nous sommes arrivés d’Oran en 1958. Nous nous sommes installés route de Lavérune, dans la montée du Terral. Mais nous sommes repartis en Algérie à la fin de l’année et nous sommes définitivement revenus en 1962. Mon père était militaire. Arrivé à l’âge de la retraite, il a trouvé du travail dans l’étanchéité, chez Midi-Asphalte. Moi, je suis allé à l’école (Victor Hugo, Pagès) jusqu’au certificat d’études, ensuite, j’ai commencé un apprentissage de menuisier aux établissements Emile Chauvin. On a changé d’appartement : d’abord, au clos des Orangers (les Collines d’Estanove), puis au numéro 1 de la rue du Faubourg Figuerolles. Maintenant, j’habite le quartier des Cévennes.J’ai été d’abord électricien, aux établissements Redon Dalmon. Puis, j’en ai eu assez et je me suis installé comme commerçant au Plan Cabanes. J’étais le premier algérien, c’était en 1978. En 1981, j’ai changé : j’ai ouvert une boucherie orientale, 1 rue du faubourg Figuerolles, que j’ai revendue au bout de trois ans. J’ai alors repris mes fruits et légumes et je me suis installé Place Jean Jaurés. J’ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait énormément d’amis dans la communauté gitane, maghrébine, pieds-noire. Je me suis marié avec une française et j’ai été accueilli à bras ouvert par toute sa famille. Nous avons eu deux garçons dont l’un est devenu policier et l’autre travaille à Nicollin Sud.
Nous sommes arrivés d’Oran en 1958. Nous nous sommes installés route de Lavérune, dans la montée du Terral. Mais nous sommes repartis en Algérie à la fin de l’année et nous sommes définitivement revenus en 1962. Mon père était militaire. Arrivé à l’âge de la retraite, il a trouvé du travail dans l’étanchéité, chez Midi-Asphalte. Moi, je suis allé à l’école (Victor Hugo, Pagès) jusqu’au certificat d’études, ensuite, j’ai commencé un apprentissage de menuisier aux établissements Emile Chauvin. On a changé d’appartement : d’abord, au clos des Orangers (les Collines d’Estanove), puis au numéro 1 de la rue du Faubourg Figuerolles. Maintenant, j’habite le quartier des Cévennes.J’ai été d’abord électricien, aux établissements Redon Dalmon. Puis, j’en ai eu assez et je me suis installé comme commerçant au Plan Cabanes. J’étais le premier algérien, c’était en 1978. En 1981, j’ai changé : j’ai ouvert une boucherie orientale, 1 rue du faubourg Figuerolles, que j’ai revendue au bout de trois ans. J’ai alors repris mes fruits et légumes et je me suis installé Place Jean Jaurés. J’ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait énormément d’amis dans la communauté gitane, maghrébine, pieds-noire. Je me suis marié avec une française et j’ai été accueilli à bras ouvert par toute sa famille. Nous avons eu deux garçons dont l’un est devenu policier et l’autre travaille à Nicollin Sud.
Vous savez, quand on est jeune, on fait des erreurs. A l’ouverture de ma boucherie orientale, je menais une vie turbulente, je ne respectais pas les règles de ma tradition qui sont de ne pas boire d’alcool, de faire la prière, le ramadan. De plus, j’étais marié avec une française. Alors les gens ont décidé de ne pas acheter chez moi. Mon commerce a coulé. J’étais jeune, et je me suis mis en colère. J’ai acheté un cochon vivant et je me suis promené avec dans les rues, par provocation. Quand les gens ont vu ça, finalement, ils l’ont bien pris et m’ont tous respecté. On s’est retrouvé au bar des sports avec tous mes amis. C’est que je n’étais pas un mauvais garçon ; j’aidais beaucoup les gens, bénévolement, pour leur trouver du travail, je leur lisais les lettres. J’ai beaucoup d’amis qui m’adorent. J’ai même soutenu Georges Frêche et Michel Belorgeot. On allait leur coller les affiches. Je l’ai fait parce que je suis ouvrier, pour les ouvriers, et parce que Georges Frêche n’est pas raciste, qu’il est tolérant, gentil, serviable, qu’il sait régler les problèmes en 48 h. J’expliquais tout ça aux arabes qui avaient le droit de vote : nous sommes des citoyens ouvriers. Mon père n’était pas d’accord avec moi, il était de tradition Gaulliste et a eu de la peine quand François Delmas a été battu. Aujourd’hui, la communauté arabe est davantage répartie entre droite et gauche, elle est de plus en plus politisée, les choses ont évolué.
 Le ramadan, c’est un mois de bonheur et de santé, de bienfait pour le corps, qui dure du lever au coucher du soleil pendant 29 à 30 jours. Le vingt-septième jour, nous donnons une participation pour les pauvres : si on est une famille de 4, on donne pour 4 personnes, et ainsi de suite en fonction du nombre. Pendant un mois, l’alcool est absolument interdit, mais aussi, pas de mensonges, pas d’adultère. On doit être tolérant, bon de cœur et social. La journée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on n’a pas de relations sexuelles, on doit prier, le soir, à la mosquée si possible. Ensuite, on peut manger. Nous prenons d’abord un petit repas sucré : gâteaux, dates, café, lait. Un peu plus tard, la Chorba (voir colonne). Vers 11 h, 11 h 30, on fait un grand repas avec par exemple un tajine, du poulet aux amandes, avec la famille, les amis et on parle du pays, des actualités. Vers 3 ou 4 h du matin, on se lève et on se met à table pour un dernier repas : couscous au miel, au sucre. Puis on se recouche jusqu’à l’heure d’aller travailler. Pour nous, les journées se passent bien. Beaucoup d’entreprises ont adapté leurs horaires et nous proposent la journée continue. Mais de voir les autres manger ne nous dérange pas. Ce qui est le plus difficile, c’est de ne pas boire, peut-être aussi de ne pas fumer pour certains. Bien sûr, comme partout, il y en a qui trichent. Mais à chacun son chemin. Pour faire vraiment le ramadan, le mieux, c’est d’être au bled. Là, tout le monde le fait sérieusement. Toutefois, certains en sont dispensés : les malades, les femmes enceintes ou en période de règles, les soldats et les voyageurs ».
Le ramadan, c’est un mois de bonheur et de santé, de bienfait pour le corps, qui dure du lever au coucher du soleil pendant 29 à 30 jours. Le vingt-septième jour, nous donnons une participation pour les pauvres : si on est une famille de 4, on donne pour 4 personnes, et ainsi de suite en fonction du nombre. Pendant un mois, l’alcool est absolument interdit, mais aussi, pas de mensonges, pas d’adultère. On doit être tolérant, bon de cœur et social. La journée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on n’a pas de relations sexuelles, on doit prier, le soir, à la mosquée si possible. Ensuite, on peut manger. Nous prenons d’abord un petit repas sucré : gâteaux, dates, café, lait. Un peu plus tard, la Chorba (voir colonne). Vers 11 h, 11 h 30, on fait un grand repas avec par exemple un tajine, du poulet aux amandes, avec la famille, les amis et on parle du pays, des actualités. Vers 3 ou 4 h du matin, on se lève et on se met à table pour un dernier repas : couscous au miel, au sucre. Puis on se recouche jusqu’à l’heure d’aller travailler. Pour nous, les journées se passent bien. Beaucoup d’entreprises ont adapté leurs horaires et nous proposent la journée continue. Mais de voir les autres manger ne nous dérange pas. Ce qui est le plus difficile, c’est de ne pas boire, peut-être aussi de ne pas fumer pour certains. Bien sûr, comme partout, il y en a qui trichent. Mais à chacun son chemin. Pour faire vraiment le ramadan, le mieux, c’est d’être au bled. Là, tout le monde le fait sérieusement. Toutefois, certains en sont dispensés : les malades, les femmes enceintes ou en période de règles, les soldats et les voyageurs ».
13- La Marseillaise
 Ainsi surnommée en raison du fait qu’elle venait de Marseille, ROSA PANSEROLI était une figure typique de Figuerolles. Une fois, elle avait même été nommée Reine du carnaval.Toute en rondeur, elle partait chaque jour vendre ses produits de saison sur son vieux landau au plan cabanes : des cagaraoulettes (petits escargots blancs), des betteraves, des gros escargots (petits-gris) et tous les vendredis des pois chiches. .
Ainsi surnommée en raison du fait qu’elle venait de Marseille, ROSA PANSEROLI était une figure typique de Figuerolles. Une fois, elle avait même été nommée Reine du carnaval.Toute en rondeur, elle partait chaque jour vendre ses produits de saison sur son vieux landau au plan cabanes : des cagaraoulettes (petits escargots blancs), des betteraves, des gros escargots (petits-gris) et tous les vendredis des pois chiches. .
La cagaraoulette
Ce petit escargot fut un temps une spécialité culinaire figuerollienne. Il s'agit du Limaçon de Pise, ou Escargot des dunes, en latin Theba Pisana. On le trouve en été sur les tiges de fenouil, de genët, voire sur les simples piquets métalliques ou autres. Il attend la nuit pour brouter les alentours et croquer à l'occasion d'autres escargots puis remonte sur son perchoir le matin venu. Aprés les avoir ramassés, les laisser une nuit dans un seau avec une poignée de farine puis les cuisiner le lendemain tout simplement à l'eau bouillante (5mn), les manger froids avec un aïoli par exemple, mais on peut aussi les servir chauds dans une sauce tomate. Délicieux à l'apéro...
14- Lucie Bruel
Lucie Bruel est née en 1903. Arrière-arrière grand-mère, elle a accepté de nous parler de sa vie. De son mari, Emile, né en 1905 et décédé en 2000. Si elle a fait beaucoup d’efforts pour rassembler ses souvenirs, c’est pour les lecteurs d’un journal qu’elle lit depuis toujours et qui était au centre d’une vie d’engagements. Merci, Lucie.
 J’ai passé une grande partie de ma vie dans le faubourg Figuerolles, au numéro 4 de la rue de Lavérune (aujourd’hui baptisée rue du Père Fabre). On y est arrivé en 1928 et on est reparti en 1974. Quarante six ans dans cette petite maison, juste en face de la rue St Blaise, au premier étage. Je suis née à Bourgueil, dans l’Indre et Loire, et j’y ai connu mon mari en 1927 au bal. Il faisait son service militaire et je l’ai suivi dans le midi quand on s’est mariés en 1928. Toute sa famille était à Béziers et à Sète. Le climat est meilleur ici, alors on est resté. Ensuite, je me suis inscrite à l’école Pigier, et j’ai appris le métier de sténo-dactylographe. J’ai travaillé alors dans un magasin d’articles de pêche, comme secrétaire, près du pont de Sète. On n’avait pas de désirs de grandeur, en ces temps là. On se contentait de peu. Il n’y avait pas de commodités, pas l’eau courante. Il fallait aller chercher de l’eau aux fontaines, faire sa lessive au lavoir. On se chauffait avec du coke, c’était très difficile de le faire brûler. Le dimanche, on allait se promener à pied, sur la route de Lavérune, voir nos amis, ou on allait écouter la musique au kiosque, place de la Comédie. On a eu un fils, Jacques, en 1929, qui allait à l’école Pagès, puis en 39 il y a eu la guerre. Mon mari est parti et a été fait prisonnier. Je l’ai attendu 4 ans. Tous les dimanches, je partais à Sète avec mon fils en vélo pour voir mes beaux-parents. Quand mon mari est revenu, il est passé à côté de moi et je ne l’ai pas reconnu tellement il avait changé. Mon mari travaillait à l’EDF, sur les lignes, dehors. Il a toujours été à la CGT. Ils ont drôlement bataillé, ils allaient à Paris manifester. J’étais bien d’accord avec eux. Je faisais les lettres pour le syndicat. Je suis toujours adhérente et je partage leur combat. Je me fais porter l’Hérault du Jour le samedi et le dimanche parce qu’il y a de bons articles qu’on ne trouve pas ailleurs.
J’ai passé une grande partie de ma vie dans le faubourg Figuerolles, au numéro 4 de la rue de Lavérune (aujourd’hui baptisée rue du Père Fabre). On y est arrivé en 1928 et on est reparti en 1974. Quarante six ans dans cette petite maison, juste en face de la rue St Blaise, au premier étage. Je suis née à Bourgueil, dans l’Indre et Loire, et j’y ai connu mon mari en 1927 au bal. Il faisait son service militaire et je l’ai suivi dans le midi quand on s’est mariés en 1928. Toute sa famille était à Béziers et à Sète. Le climat est meilleur ici, alors on est resté. Ensuite, je me suis inscrite à l’école Pigier, et j’ai appris le métier de sténo-dactylographe. J’ai travaillé alors dans un magasin d’articles de pêche, comme secrétaire, près du pont de Sète. On n’avait pas de désirs de grandeur, en ces temps là. On se contentait de peu. Il n’y avait pas de commodités, pas l’eau courante. Il fallait aller chercher de l’eau aux fontaines, faire sa lessive au lavoir. On se chauffait avec du coke, c’était très difficile de le faire brûler. Le dimanche, on allait se promener à pied, sur la route de Lavérune, voir nos amis, ou on allait écouter la musique au kiosque, place de la Comédie. On a eu un fils, Jacques, en 1929, qui allait à l’école Pagès, puis en 39 il y a eu la guerre. Mon mari est parti et a été fait prisonnier. Je l’ai attendu 4 ans. Tous les dimanches, je partais à Sète avec mon fils en vélo pour voir mes beaux-parents. Quand mon mari est revenu, il est passé à côté de moi et je ne l’ai pas reconnu tellement il avait changé. Mon mari travaillait à l’EDF, sur les lignes, dehors. Il a toujours été à la CGT. Ils ont drôlement bataillé, ils allaient à Paris manifester. J’étais bien d’accord avec eux. Je faisais les lettres pour le syndicat. Je suis toujours adhérente et je partage leur combat. Je me fais porter l’Hérault du Jour le samedi et le dimanche parce qu’il y a de bons articles qu’on ne trouve pas ailleurs.
 Mais la grande passion de mon mari, c’était la pêche et la chasse. Depuis toujours, nous avions une cabane à Carnon, au bord du canal. Il ramenait des pleines barques de dorades, parfois même des thons. A la chasse, beaucoup de macreuses et de canards. Un jour, il a même tué un macareux, c’est un oiseau très rare ici, et l’a fait empailler par quelqu’un de Figuerolles. Je ne me rappelle plus par qui.
Mais la grande passion de mon mari, c’était la pêche et la chasse. Depuis toujours, nous avions une cabane à Carnon, au bord du canal. Il ramenait des pleines barques de dorades, parfois même des thons. A la chasse, beaucoup de macreuses et de canards. Un jour, il a même tué un macareux, c’est un oiseau très rare ici, et l’a fait empailler par quelqu’un de Figuerolles. Je ne me rappelle plus par qui.
15- Marc Bel
 Je suis né en 1933 et en 1955, je suis employé comme coiffeur par M. Casino, le patron du salon Dominique, dont le père avait tenu une épicerie en face de la maternelle du Docteur Roux. Le salon Dominique ouvre en 1954. Avant lui, c’est une épicerie, le « Coq Hardi ». Il y avait des têtes de quartier incroyables, comme Robert le bossu, qui était coiffeur dans la rue Daru. Derrière son salon, on voyait la cuisine avec l’étendage de sa femme.
Je suis né en 1933 et en 1955, je suis employé comme coiffeur par M. Casino, le patron du salon Dominique, dont le père avait tenu une épicerie en face de la maternelle du Docteur Roux. Le salon Dominique ouvre en 1954. Avant lui, c’est une épicerie, le « Coq Hardi ». Il y avait des têtes de quartier incroyables, comme Robert le bossu, qui était coiffeur dans la rue Daru. Derrière son salon, on voyait la cuisine avec l’étendage de sa femme.
C’était un quartier cosmopolite ; j’ai vu passer toutes les catégories, toutes les nationalités dans mon salon : des professeurs, des gitans, des médecins. Le salon avait une certaine renommée, on avait été parmi les premiers à faire les coupes au rasoir. On travaillait de 7 h du matin à 9 h du soir. Le 31 décembre, on coupait jusqu’à 1 h du matin. J’ai arrêté en 1996. J’habite rue de la Monnaie, mais je reviens faire un tour tous les jours. Les gens se sentaient en sécurité dans le quartier. Quand ils revenaient de la ville, dès qu’ils arrivaient Rue Daru, ils disaient : « Ouf, maintenant, il ne peut plus rien nous arriver ».
Manitas de Plata venait jouer dans le salon quand il était jeune. Il disait : « Un jour, je serai une vedette ». Il avait sur lui une lettre de félicitations de la Reine d’Angleterre, sa relique. Puis, il est devenu une vedette, et il n’est plus venu jouer. J’ai passé 41 ans là, et c’est l’ambiance, la chaleur du quartier qui m’attire et qui y est toujours, comme quand on partageait les grillades dans la rue. Tout le monde y vit en communauté. Les maghrébins remettent le feu au quartier. Sans eux ils serait mort. Il n’y a pas plus de problèmes ici qu’ailleurs.
16- Marguerite Meyer : Gitane
« Mon père est né à Béziers, ma mère à Nîmes. Nous sommes trois sœurs. Nous sommes toutes nées à la maternité de Montpellier, nous avions cinq ans de différence.La première c'est ma sœur Nathalie (Thalie), puis moi Rosette. La troisième c'est Mado.
 Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents voyageaient. Nous, on avait une adresse. On habitait 18, rue Saint-Étienne à Montpellier, c'était un petit immeuble où chaque famille avait une pièce. La sœur de mon père avait quatre enfants dans une seule pièce, sa nièce avait trois enfants, donc ça faisait cinq avec son mari, eux c'était au rez-de-chaussée.
Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents voyageaient. Nous, on avait une adresse. On habitait 18, rue Saint-Étienne à Montpellier, c'était un petit immeuble où chaque famille avait une pièce. La sœur de mon père avait quatre enfants dans une seule pièce, sa nièce avait trois enfants, donc ça faisait cinq avec son mari, eux c'était au rez-de-chaussée.
Ma grand-mère Dolorès, la mère de mon père, avait son frère avec elle, là c'était au premier étage. Le cousin de mon père, lui, vivait avec sa mère au fond de la cour
Nous on était cinq, on avait aussi une seule pièce. On a fait mettre une moitié de cloison, ça nous a fait deux pièces. C'était au premier étage. On dormait tous dans la même chambre, il y avait deux grands lits. Avec mes sœurs, on dormait dans un lit, mon père et ma mère dans l'autre lit. Il y avait une grande armoire en bois entre les deux lits. Une fenêtre dans la chambre, qui donnait sur la cour. La cuisine avait un grand placard en tôle, moi-même je l'ai maintenant, je l'ai mis dans la cuisine et on l'a repeint.Il y avait aussi une petite table en bois, que j'ai aussi. Et quelques chaises rempaillées par les mains de mon père. On n'avait pas beaucoup de meubles. Il n'y avait pas l'eau, on allait la chercher à la fontaine. Plus tard, on a fait placer l'eau et un évier.
Ma copine Lili
Elle s'appelait Henriette, on l'appelait Lili. Ma copine Lili et moi on était très copines. Sa grand-mère c'est elle qui l'élevait. Elle habitait dans la rue de Metz et moi dans la rue Saint-Étienne. On n'habitait pas très loin toutes les deux.
La maison de la grand-mère de Lili, c'était deux pièces comme chez nous, mais ils n'avaient pas de cloison. Il y avait aussi son frère qui habitait avec eux. Il y avait une cuisine et une chambre. La grand-mère était dans la chambre avec Lili, et le frère dans la cuisine, sur un lit pliant. Il y avait une cuisine avec une cheminée, une petite fenêtre, un évier en pierre, un placard en bois. Puis une chambre, une petite fenêtre, un grand lit en bois, une armoire et une table de nuit en bois. On n'avait pas de jouets. Lili n'a pas connu sa mère, je ne crois pas.
Son artiste préféré c'était Luis Mariano.
Le grand Père Bourli
C'était le surnom du père de mon père. Jaiou Bourli, il y avait un orchestre qui avait ce nom-là. Son vrai nom c'est Auguste Comabella. A mon grand-père on avait donné une adresse, pour venir tondre un chien, le lendemain. A cette adresse, on lui a donné un coup de crosse derrière la nuque. Ils l'ont assassiné. Nous on revenait du cinéma, avec Lili, ma copine. Il y avait beaucoup de monde devant chez nous. "Hou, qu'est-ce que c'est ?" On est monté. Mon grand-père me regardait, il était essoufflé. Mon oncle nous a vues : « Qu'est-ce que c'est, allez, descendez maintenant ». Il est mort dix minutes après, j'ai vu mon grand-père mourir.
La police n'a rien fait, ils n'ont pas cherché. Peut-être que maintenant ils chercheraient. Jamais ils n'ont trouvé qui était le coupable. Mais mon grand-père avait donné un petit signalement : "Un petitou, un peu costaud, tout brun". Mais il y en a tellement comme ça. On lui avait fait un piège, ils croyaient que mon grand-père était riche, et ils l'ont tué à coups de crosse de pistolet. Maintenant il doit être vieux, l'assassin, peut-être qu'il est mort. Ils étaient deux, mais un seul l'avait tapé. Je crois qu'ils se sont trompés, c'est pour un autre qu'ils l'avaient fait, ce message pour tondre un chien. Mon grand-père y est allé en croyant que c'était pour lui. Je l'ai entendue comme ça, l'histoire.
Il y en a toujours, de ces criminels qui tuent. Mon grand-père Bourli est né en 1876, il est décédé en 1944. Je suis allée aujourd'hui sur la tombe de mon grand-père. J'ai regardé la plaque sur cette tombe, c'est là que j'ai vu cette date. Donc je me suis dit que j'avais sept ou huit ans, mais je croyais plus que ça : je me souviens toujours que moi et ma copine Lili on l'a vu presque mourir, c'était un après-midi entre quatre et cinq heures, voilà tous mes souvenirs. J'étais très jeune, mais j'ai toujours ce souvenir.
Ma grand-mère Dolorès
 La mère de mon père, son nom Dolorès Comabella, née Bousquet. Elle était très gentille aussi, ma grand-mère Dolorès. Je me rappelle quand j'allais la voir à la maison. J'allais lui faire ses courses. Puis elle me donnait le gouter. En ce temps-là, la vie était très chère. Il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Maintenant il y a beaucoup d'aide. Avec ma grand-mère Dolorès, j'allais souvent au cimetière Saint-Lazare, au vieux, sur la tombe de mon grand-père, celui qui a été tué par des gens imbéciles et criminels à la fois. Ma grand-mère a eu beaucoup de chagrin de la mort de son mari. Mon père, mes oncles, mes tantes aussi, quand ils ont vu leur père mort par la faute de ces fous imbéciles et criminels à la fois.
La mère de mon père, son nom Dolorès Comabella, née Bousquet. Elle était très gentille aussi, ma grand-mère Dolorès. Je me rappelle quand j'allais la voir à la maison. J'allais lui faire ses courses. Puis elle me donnait le gouter. En ce temps-là, la vie était très chère. Il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Maintenant il y a beaucoup d'aide. Avec ma grand-mère Dolorès, j'allais souvent au cimetière Saint-Lazare, au vieux, sur la tombe de mon grand-père, celui qui a été tué par des gens imbéciles et criminels à la fois. Ma grand-mère a eu beaucoup de chagrin de la mort de son mari. Mon père, mes oncles, mes tantes aussi, quand ils ont vu leur père mort par la faute de ces fous imbéciles et criminels à la fois.
Ma grand-mère est née en 1889, et elle est morte en 1967. Elle avait son frère avec elle. Il était un peu âgé. Son frère n'a jamais été marié. Un vieux jeune homme c'était. Ma grand-mère elle l'a toujours gardé avec elle, car il ne savait pas où aller. Son nom : Auguste Bousquet, né en 1903, et mort en 1979.L'appartement de ma grand-mère n'avait qu'une pièce. Il y avait un petit coin et c'est là que son frère dormait. Elle, ma grand-mère, avait un grand lit, puis à côté elle avait mis une grande armoire de grand-mère, très ancienne. Elle avait un poêle à charbon, une table contre le mur. Il n'y avait qu'une fenêtre, un petit placard où elle mettait toute sa vaisselle, et quelques chaises en bois. Il y avait un escalier à monter pour entrer chez elle, car elle habitait au premier étage.
Des fois le soir on allait passer un moment, elle nous donnait un lait au chocolat. Elle nous demandait si on avait faim. On lui répondait : "Non, grand-mère, on n'a pas faim". Nous avons été au cimetière de Grammont. C'était samedi 14 janvier 1995, avec mes deux filles et ma petite-fille âgée de quatre ans. On voulait acheter des fleurs, mais il n'y avait pas de marchand, et donc on n'a pas eu de fleurs pour mettre sur la tombe de ma grand-mère. Ma petite-fille âgée de quatre ans a ramassé des pignes, et elle les a posées sur la tombe, comme un bouquet de fleurs. On l'a laissé faire.
17- Mattt Konture
 Mattt s’écrit bien avec trois t. En fait, il y a trois raisons à cela. La première, c’est parce que c’est plus joli, la seconde c’est que mon prénom c’est Mathieu et que ces trois t rappellent le th, et la dernière parce que ces trois t rappellent les trois croix du calvaire du Christ. En fait, je suis né en 1965 à Viry-Chatillon dans l’Essone. Je suis à Figuerolles depuis 1999. Avant, j’habitais à La Paillade, quand un copain a proposé à ma copine d’aller construire une cabane dans les Cévennes. Elle est partie avec lui et notre fille. Un ami m’a alors proposé un appartement du côté de la rue du Courreau, en face de l’école maternelle Francis Garnier. Depuis, je vis là.
Mattt s’écrit bien avec trois t. En fait, il y a trois raisons à cela. La première, c’est parce que c’est plus joli, la seconde c’est que mon prénom c’est Mathieu et que ces trois t rappellent le th, et la dernière parce que ces trois t rappellent les trois croix du calvaire du Christ. En fait, je suis né en 1965 à Viry-Chatillon dans l’Essone. Je suis à Figuerolles depuis 1999. Avant, j’habitais à La Paillade, quand un copain a proposé à ma copine d’aller construire une cabane dans les Cévennes. Elle est partie avec lui et notre fille. Un ami m’a alors proposé un appartement du côté de la rue du Courreau, en face de l’école maternelle Francis Garnier. Depuis, je vis là.
C’est en CM2 que j’ai senti que je pouvais dessiner. Et à partir de ce moment, j’ai commencé, inspiré par Dubout, Gotlib, l’équipe de Fluide Glacial, Métal Hurlant. Au lycée, je me suis lancé dans un petit journal « verre d’éther », qui a quand même duré trois ans, avec des copains. Moi bien sûr, je dessinais. Quand j’ai terminé ma scolarité, je suis allé à Paris. J’y ai rencontré Picotto, un auteur connu. En voyant mes dessins, il m’a orienté vers Viper, une revue qui paraissait en kiosque. J’y ai publié mes premières planches dans le numéro du nouvel an 1984. Puis, j’ai rencontré la petite équipe d’un fanzine qui s’appelait « Le lynx à tifs », qui est devenu «Le lynx », puis « Labo », chez Futuropolis. J’ai dessiné sur les trois, puis Labo est devenu « L’association », une maison d’édition indépendante dont je suis un des membres fondateurs. Depuis, j’y publie des albums, des comics. J’ai aussi participé à la revue « Psikopat ».
 Dans Définistaire (le dictionnaire des mots qui n’existent pas mais c’est pas grave), un anartiste est défini comme un artiste anarchique. Marcel Duchamps s’était qualifié anartiste, le peintre plasticien René Grégogna de Frontignan aussi. Il existe même une revue de ce nom créée en 1997 par la Fédération Anarchiste.. Il n’empêche que j’ai eu l’impression d’inventer ce mot moi-même, qu’il correspond bien à un quartier où il y a beaucoup d’artistes et de libertaires.
Dans Définistaire (le dictionnaire des mots qui n’existent pas mais c’est pas grave), un anartiste est défini comme un artiste anarchique. Marcel Duchamps s’était qualifié anartiste, le peintre plasticien René Grégogna de Frontignan aussi. Il existe même une revue de ce nom créée en 1997 par la Fédération Anarchiste.. Il n’empêche que j’ai eu l’impression d’inventer ce mot moi-même, qu’il correspond bien à un quartier où il y a beaucoup d’artistes et de libertaires.
Mon style est rattaché à celui de la BD underground américaine des années 60. Les gens m’assimilent à Crumb, qui comme moi, utilise des hachures. Ce qui caractérise surtout le style underground, c’est le désir de faire des choses en dehors du système commercial. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne cherche pas à vendre nos albums, mais qu’on les fait par goût, parce qu’on a quelque chose à dire. Ce qui prime pour moi, c’est l’expression. Je fais beaucoup d’autobiographie, des expériences d’improvisation.
18- Miloud Abouhafs
 Miloud Abouhafs est coiffeur. Il fait partie de ces gens heureux qui ont réalisé le rêve de leur vie. Son rêve à lui, c’est manier le ciseau. Pour lui, le ciseau est un objet culte : il en a accumulé une impressionnante collection, aux alentours de 500, des merveilles (peut-être une exposition, un jour ?). En fait, dès l’âge de 12 ans, sans trop savoir comment il en est arrivé là, il coiffe toute sa famille. Plus tard, soudeur dans une entreprise, entre midi et deux, il coupe les cheveux de ses collègues. A l’époque son chef d’atelier lui avait prédit « Tu finiras coiffeur au plan Cabanes ». Il ne croyait pas si bien dire.
Miloud Abouhafs est coiffeur. Il fait partie de ces gens heureux qui ont réalisé le rêve de leur vie. Son rêve à lui, c’est manier le ciseau. Pour lui, le ciseau est un objet culte : il en a accumulé une impressionnante collection, aux alentours de 500, des merveilles (peut-être une exposition, un jour ?). En fait, dès l’âge de 12 ans, sans trop savoir comment il en est arrivé là, il coiffe toute sa famille. Plus tard, soudeur dans une entreprise, entre midi et deux, il coupe les cheveux de ses collègues. A l’époque son chef d’atelier lui avait prédit « Tu finiras coiffeur au plan Cabanes ». Il ne croyait pas si bien dire.
Né le 13 décembre 1950 à Oran, Miloud Abouhafs est d’origine marocaine. A 19 ans, il vient en touriste dans la région de Marseille, voir son frère, qui travaille dans la ferronnerie. Malheureusement, au même moment, ce frère a un très grave accident de moto et se retrouve hospitalisé. Le patron demande alors à Miloud s’il peut assurer le remplacement. Miloud accepte. Un an plus tard, il est embauché pour 10 ans dans une autre entreprise qui fabrique des casiers pour bouteilles de gaz, perfectionne son savoir-faire de métallier, puis travaille encore deux années, cette fois dans la restauration. Mais on est toujours à côté de la véritable passion de notre homme : la coiffure.
Milhoud Abouhafs décide alors de repartir au Maroc en 1984. Il va y chercher un diplôme : le brevet de coiffeur pour homme tant désiré que délivre une école de Casablanca. Une année de pratique et de formation, et Miloud revient en France, chez sa sœur qui réside à Montpellier. Il lui faut travailler, mais il hésite encore à s’installer et fait le tour des agences d’intérim. « J’ai vu une annonce qui demandait un soudeur très, très, très qualifié. Trois fois très ! Comme je savais faire, je suis entré, et ils m’ont embauché immédiatement. C’était l’entreprise Valindus, en face du marché-gare. Je devais y souder des châssis d’ordinateurs pour IBM ». Mais cette entreprise connaîtra des difficultés qui l’amèneront à licencier son personnel.
Au final, le brevet obtenu à Casablanca ne va pas servir qu’entre midi et deux chez Valindus : « Un coiffeur venait d’ouvrir rue Figuerolles, et je suis venu l’aider. Je suis resté avec lui 5 ans. Ensuite, il a changé de local et s’est établi un peu plus haut. Je l’ai suivi. Beaucoup de mes amis m’ont conseillé d’ouvrir mon propre salon, et finalement, en 1995, je me suis décidé. Et depuis, je suis toujours là, malgré une très forte concurrence ». Quand il nous parle de sa clientèle, Miloud est intarissable. Toutes les nationalités, toutes les professions se succèdent sous ses doigts d’argent. Elus, médecins, avocats, policiers, professeurs, journalistes y côtoient maçons, épiciers, bouchers, mécaniciens, artistes, chômeurs et rmistes.
C’est dire s’il s’en échange, des secrets, des points de vue, des réflexions : « Avec mes clients, on parle beaucoup. On se raconte des blagues, on parle du bien et du mal, on me confie ses problèmes conjugaux ou financiers, les difficultés à trouver du boulot ou un logement. Je conseille, autant que je peux, j’aide à ma façon, je mets en relation. Tous mes clients sont devenus des amis, à force de venir ; j’adore les voir arriver. J’aime beaucoup mon métier. Heureusement : je travaille 12 heures par jour, de 8 h du matin à 8 h du soir. D’ailleurs, le matin, tôt, ce sont surtout les personnes âgées qui viennent se faire couper les cheveux ».
Miloud nous explique que si se sont quasiment exclusivement des hommes qui viennent le voir, il a tout de même une certaine clientèle féminine. Parmi les célébrités, l’épouse du footballeur Roger Milla (classé meilleur footballeur africain par les internautes). « Les femmes maghrébines ne vont pas beaucoup chez le coiffeur, elles se débrouillent entre elles ou vont dans des salons français. Il y a très peu de coiffeurs pour dames tenus par des maghrébins ; un rue Guillaume Pélissier et un autre à la Paillade ».
Ce qui est extraordinaire chez Miloud Abouhafs, c’est son salon : magnifique, décoré d’une multitude de cartes postales et de photos. « Ces cartes, ce sont les clients qui me les envoient quand ils voyagent. J’en reçois du monde entier. Ils me font voyager, moi aussi. Les photos, ce sont des gens que j’aime : Brassens, Zidane. Il y a aussi des équipes algériennes de foot glorieuses dans les années 70, comme le CRB Belcourt ou le Mouloudia d’Oran… » Le salon de Miloud s’appelle Al Bouchra, ce n’est pas un nom pris au hasard « Al Bouchra, ça signifie La bonne nouvelle, parce qu’ici, il n’y a que des bonnes nouvelles, venez et vous verrez ». Sans rendez-vous, un endroit incontournable qui vaut le coup de ciseau. 500 paires au choix. A visiter une fois par mois….
Thierry Arcaix
Al Bouchra coiffure, 11, rue du faubourg Figuerolles, 34070 Montpellier. Parking Gambetta. Tel. 04 67 06 58 47
19- Moss
La librairie l’Art de Lire à Ganges et la brasserie Les Berges à Laroque présentent du 8 au 31 mars 2008 l’exposition d’un peintre atypique et exceptionnel, dont les œuvres s’arrachent pas plus tôt exposées. A partir de bois flottés assemblés et peints à l’acrylique, de divers objets de récupération mais aussi sur toiles, Moss, puisque c’est de lui qu’il s’agit, nous présente un travail coloré, contrasté, à la fois tragique et dynamique, plein de vie mais aussi de douleur et de profondeur. Le vécu de l’artiste y est pour beaucoup. Explications.

Moss est né en 1952 à Alger. A dix ans, il arrive en France avec son père, qui était croupier dans les casinos. Une scolarité chaotique, mais avec un rêve permanent : devenir dessinateur de BD. Puis, il commence à travailler, en usine, où il construit sa conscience politique. Ensuite, il prend la profession de son père : à Londres, en Grèce et dans les plus grands casinos français. Une époque d’abondance, où il gagne très bien sa vie. Mais les choses se gâtent lorsque la maffia turinoise rachète le casino où il travaille : « J’étais directeur des jeux, et leur objectif était de licencier du personnel. J’ai donc décidé de créer un syndicat pour sauver les emplois. Je me suis immédiatement fait virer, mais en plus, j’ai été marqué à l’encre rouge : plus possible de me faire embaucher dans un autre casino… »
Avec sa prime de licenciement, Moss achète une pizzeria au Grau du Roi. Mais ce n’était pas son métier, ça ne marche pas. Puis son père, qui s’était porté caution, tombe gravement malade. Face aux charges impayées qui s’accumulent, Moss (qui peint toujours) doit trouver une solution. « Comme j’avais besoin d’argent et que j’avais beaucoup de connaissances dans le milieu, je suis entré dans le grand banditisme. Machines à sous, braquage de banques, dans l’Hérault, le Gard, les Bouches du Rhône. En moyenne, un braquage par semaine. On avait de fausses identités, des planques. Puis un jour, à la sortie d’une banque, à Lunel, je me suis fait arrêter. On m’a tiré une balle dans le dos, presque à bout portant, qui m’a traversé le foie et a fini sa course dans la cuisse d’un dame qui passait par là. Mon ami a reçu une balle qui lui a arraché trois doigts. Nous n’étions pas armé, mais cela faisait longtemps que la police essayait de nous arrêter sans y arriver ».

Moss sera condamné à 13 ans de prison, il en fera 7, de 1997 à 2004. 4 ans à Villeneuve les Maguelonne, 3 ans en centrale à Toulouse. L’enfer sur terre, nous décrit-il : « un univers d’une violence extrême, une machine à briser les vies » dont il va s’évader en peignant, jusqu’à 10 heures par jour. A l’extérieur, sa sœur, une sétoise, va lui organiser des expositions avec le soutien du maire, François Liberti. N’ayant pas le droit de donner son vrai nom , il inventera son pseudonyme Moss, qui est aujourd’hui pour tout le monde son seul nom.
En prison, il va faire une rencontre inattendue : José Bové. Tout de suite, le courant passe : « Un homme droit, honnête, qui a tout de suite compris le système carcéral. Je l’ai aidé à prendre ses marques dans cet univers qu’il ne connaissait pas et il a fait l’unanimité. Quand il est sorti, il a pris contact avec ma sœur, il m’a fait exposer à Millau, il m’a choisi comme invité quand il est passé à l’émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Il est venu à mon procès et depuis, on se voit régulièrement. Il m’a fait connaître d’un tas d’artistes. J’ai travaillé pour le journal du Larzac où j’ai créé un personnage : Habens Minus ».
A sa sortie de prison, Moss va recevoir la vie « en pleine gueule », dit-il : les voitures, les chiens, les enfants… Sa fille qui avait 6 mois quand il était entré, a alors 7 ans et demi. « C’est là que je me suis promené sur la plage, et que j’ai ramassé du bois flotté. Puis j’ai commencé à le peindre, à l’assembler. Je me suis installé dans un mobil-home, à la Grande Barge, à Villeneuve les Maguelone. Peu à peu, j’y ai construit ma nouvelle vie d’artiste, j’ai obtenu un agrément DRAC, monté des évènements, aidé par Sylviane Compan, la personne qui animait les ateliers d’arts plastiques en prison ».

Moss a définitivement tourné la page d’une première vie, sauvé par son art et sa passion. Aujourd’hui et pour plusieurs raisons, il fréquente assidûment le quartier Figuerolles à Montpellier. En effet, certains jeunes de la Cité Gély qui l’ont rencontré en prison et qu’il aime bien revoir le considèrent comme le modèle de celui qui a su s’en sortir ; il y retrouve tout un réseau d’artistes, ses copains, autour de lieux mythiques, comme La Pleine Lune et dans un univers maghrébin, qui est sa culture d’origine. Moss nous invite au festival des Arts Singuliers, à l’organisation duquel il travaille, qui aura lieu à Villeneuve les Maguelone, du 8 au 18 avril.
Contacter Moss : 06 10 77 15 08.
20- Mounir Letaief
Rencontre avec une figure de la place Salengro
 « Je suis né à Aousdja, en Tunisie, en 1960. Quand j’avais 17 ans, je suis venu passer mes vacances à Toulon chez mon oncle. J’avais un cousin à Montpellier qui est venu me voir. Je l’ai suivi. J’ai trouvé alors un patron qui m’a fait un contrat de travail, puis j’ai régularisé ma situation. Un beau jour, j’ai déclaré à ma femme : « Je vais ouvrir mon entreprise » Comme elle était un peu inquiète, je l’ai rassurée : « Je suis un ouvrier ; si je réussis comme patron, tant mieux, si je ne réussis pas, je redeviendrai un ouvrier ! .
« Je suis né à Aousdja, en Tunisie, en 1960. Quand j’avais 17 ans, je suis venu passer mes vacances à Toulon chez mon oncle. J’avais un cousin à Montpellier qui est venu me voir. Je l’ai suivi. J’ai trouvé alors un patron qui m’a fait un contrat de travail, puis j’ai régularisé ma situation. Un beau jour, j’ai déclaré à ma femme : « Je vais ouvrir mon entreprise » Comme elle était un peu inquiète, je l’ai rassurée : « Je suis un ouvrier ; si je réussis comme patron, tant mieux, si je ne réussis pas, je redeviendrai un ouvrier ! .
J’ai commencé comme marchand ambulant, au marché de la Paillade. Puis, j’ai ouvert trois magasins sur le Cours Gambetta. Mais, en 1986, j’ai été exproprié par la municipalité qui a mis à ma place le poste de police municipale (vite fermé d’ailleurs). Ensuite, j’ai acheté l’ancien magasin COOP qui se trouvait à l’angle de la rue Guillaume Pellicier et de la place Salengro.. On a ouvert en 1990 un restaurant à Carnon (La Lambada) ; en 1995 un restaurant et une épicerie en face de la Sécurité Sociale, Cours Gambetta, une épicerie rue de Verdun, une autre à Lunaret, un restaurant en face de mon premier magasin, rue Guillaume Pellicier, un magasin de fruits et légumes à côté de la pêcherie et enfin un autre magasin rue Méditerranée. Je suis également propriétaire d’une usine de confection à Tunis qui emploie 300 employés.
Là-bas, je m’occupe de la fabrication de Jeans pour de grandes marques. Cette entreprise a connu quelques difficultés en 2005 en raison de la concurrence chinoise, mais en 2006 tout est reparti de plus belle, car les façonniers sont revenus en tunisie. Ils n’avaient pas trouvé la même qualité. Nous avons repris une activité encore plus prospère qu’avant. Je dirige mon entreprise d’ici. J’ai comme projets de mettre en place une unité de délavage de jeans à Tunis, et ici de développer la vente en gros de tous les produits alimentaires en provenance du Maroc et de Tunisie.
C’est à Figuerolles que je suis le plus souvent. C’est un quartier qui est vivant 21 h sur 24 ; il y a de la vie jusqu’à 2 h du matin, et tout redémarre à 5 h ! C’est un quartier qui ne dort jamais. Montpellier est une ville universitaire qui attire des gens de toute la France et de l’étranger. Les parents des étudiants, quand ils viennent les voir, s’ajoutent aux touristes qui viennent à Figuerolles visiter ce qu’ils appellent le quartier arabe et son marché, réputé le moins cher de la ville.
Non ; nous sommes cinq frère : Amor, Jalel, Icham, Karim et moi. Mes filles aussi travaillent avec nous. Ce qui marche le mieux, c’est l’alimentation. L’épicerie de proximité est quelque chose d’indispensable : les gens ne peuvent pas aller sans arrêt au supermarché. Avec les épiceries de nuit, on fait beaucoup d’heures, mais c’est ce qui rapporte le plus. La restauration demande des professionnels. Il n’y en a pas assez sur le marché de l’emploi. Un serveur peut se former en une journée, pour un cuisinier il faut une longue formation. Dans l’alimentation, ranger la marchandise, étiqueter, tenir la caisse, c’est vite appris. On trouve donc plus facilement de la main d’œuvre.Je ne suis d’aucun côté politique. Je ne veux pas entrer dans ce type de jeu. Je ne soutiens pas Jacques Domerge parce qu’il est du côté de Nicolas Sarkozy. Ce qui nous avait un temps rapprochés, c’était la politique internationale par rapport à l’Irak. Je suis un commerçant qui souhaite que le quartier s’embellisse. Je suis pour que l’on ait de beaux magasins, de beaux restaurants et je suis prêt à investir pour cela. Plus les commerces se développeront, plus il y aura de concurrence, plus l’activité de chacun sera importante. Il y a près de 200 commerces dans le quartier. Approximativement répartis entre 10 tunisiens, 50 à 100 marocains, 50 algériens, 5 sénégalais et 30 français. On a besoin de ce mélange. La Pleine Lune, avec ses animations amène beaucoup de gens de l’extérieur ; La Pêcherie apporte le plus beau poisson de la région et nous, nous vendons une viande de très bonne qualité. Comme nous avons des contrôles permanents des services des fraudes et de l’hygiène, nous nous modernisons tous sans cesse…»
21- Maurice Guillaume
En 1957, le soldat de deuxième classe Maurice Guillaume faisait son service militaire à Aix en Provence, dans l’aviation. Il a attendu 28 mois un éventuel départ pour l’Algérie qui n’a jamais eu lieu. Sur une carte postale retrouvée par hasard, il a écrit en 1958 les mots suivants : .« A tous les citoyens de la Commune Libre de Figuerolles qui ont bien voulu participer au colis de Noël pour les militaires, avec tous mes remerciements ».
M.G : «C’était la grande époque de la Commune Libre. Hervé Reynes en était le maire, il se donnait à fond pour le quartier. Il organisait des animations et récoltait de l’argent pour les personnes âgées et les militaires. On recevait des colis que nos familles n'avaient pas les moyens de nous envoyer et quand on venait en permission, on recevait une enveloppe pour aller au cinéma, au bal, boire un coup. Je suis à Figuerolles depuis l’âge de dix ans. Avec mes parents, on a aménagé dans la Grande Maison, cet important immeuble situé entre le faubourg et la cité Gély, je crois, en 1958, quand la deuxième tranche a été finie, et j’y habite toujours. Le quartier bougeait 24 h sur 24 à ce moment là. On organisait le bal dans la cour, là, en bas. Il y avait du cinéma en plein air, au gardiennage, ce terrain en face. Il y en avait aussi rue Reynes et à la salle Familia, en face de la rue de Metz. Les gens, parlaient, applaudissaient pendant la projection, comme au théâtre. On regardait souvent des films avec Luis Mariano. Je me souviens aussi de Jules et Jim, de Jill la jungle ».
22- Pierre Rainard
« Mon père, Armand, a ouvert cette cordonnerie, 63 rue du faubourg Figuerolles, en 1969. J’ai commencé à travailler avec lui à 13 ans ; j’ai été pré apprenti, puis apprenti et j’ai passé mon CAP à Nîmes. Dans notre classe, on n’était que 2 cordonniers, les deux seuls garçons pour une vingtaine de filles qui préparaient des CAP de gantière, de fleuriste, d’esthéticienne. Ma formation a duré deux ans, de 16 à 18 ans. Ensuite, j’ai travaillé ici jusqu’à 20 ans, puis je suis allé faire mon service militaire dans les chasseurs alpins à Grenoble, au 6ème BCA et je suis revenu.
Mon père, Armand, a ouvert cette cordonnerie, 63 rue du faubourg Figuerolles, en 1969. J’ai commencé à travailler avec lui à 13 ans ; j’ai été pré apprenti, puis apprenti et j’ai passé mon CAP à Nîmes. Dans notre classe, on n’était que 2 cordonniers, les deux seuls garçons pour une vingtaine de filles qui préparaient des CAP de gantière, de fleuriste, d’esthéticienne. Ma formation a duré deux ans, de 16 à 18 ans. Ensuite, j’ai travaillé ici jusqu’à 20 ans, puis je suis allé faire mon service militaire dans les chasseurs alpins à Grenoble, au 6ème BCA et je suis revenu.
J’ai repris l’affaire à mon nom il y a 13 ans, quand mon père a pris sa retraite. J’ai 40 ans, et je suis là depuis 27 ans.De vrais cordonniers, sur Montpellier, on est une dizaine, pas plus. Je ne vous parle pas des supermarchés où il y a des multiservices avec des gens qui n’ont pas appris le métier. Ils ont fait des stages de 3 semaines à 1 mois, pas plus. Par exemple, ils ne font pas le ressemelage cousu. Ils n’ont pas de bonnes machines. On n’est plus que 4 ou 5 à en avoir en ville. La mienne coûte plus de 15 000 €. Je couds pour d’autres cordonniers.
Mais notre métier se perd. Ce sont les baskets qui l’ont tué. Et pourtant c’est une très mauvaise chaussure : il n’y a pas de tenue, le pied s’élargit, on y transpire et on attrape des mycoses. Ils sont chers et on ne peut quasiment pas les réparer.Tout a commencé dans les années 70. A ce moment là, beaucoup de cordonniers se sont diversifiés : clés, tampons, cartes de visite, plaques d’immatriculation. Mais 20 à 30% de la population n’a pas abandonné la chaussure de qualité, en cuir, qui se répare bien et qui maintient bien le pied. Quand vous achetez de bonnes chaussures, vous allez les payer 300 ou 400 €, mais vous allez les garder 15 ans. Alors, faites vos comptes.
La Rolls des chaussures, c’est la Weston, ou la Church’s ; la Paraboot aussi, un peu moins chère. Vous en trouverez dans les boutiques de luxe du centre ville, ou tiens, chez Escassut, un ancien du quartier. On voit aussi revenir les bottes, Santiag ou Camarguaise, en cuir, cousues. Les gens commencent à en avoir assez de porter de la camelote. Au départ, la basket, c’était pour le sport, aujourd’hui, on les met tous les jours. Et puis, on jette dès que c’est usé, à fond dans la société de consommation, c’est irréparable ! Mais le vent tourne Les cordonniers ont disparu de nos villages et commencent même à disparaître de nos villes. Les derniers sont de bonnes adresses que l’on se transmet entre copains. Dans le temps, les cordonniers ne se contentaient pas de réparer, mais aussi fabriquaient des chaussures, des bottes. Pierre Rainard a appris cette technique, même si aujourd’hui, les cordonniers ne fabriquent plus sur mesure. Il nous signale quelques ateliers, à Paris qui travaillent exclusivement pour les gens du show-biz et les hommes politiques, à des prix hallucinants».
Quand Pierre Rainard parle de la formation qu’il a reçue à Nîmes, il est très critique. Pour lui, c’est sur le terrain qu’on apprend vraiment, et c’est surtout à son père qu’il doit son savoir faire. « On nous apprenait des techniques trop anciennes, comme par exemple fabriquer son fil avec des brins de chanvre et de la poix. Une longueur d’une brassée, brin par brin, avec à chaque extrémité, une aiguille en soie de sanglier, des poils tressés bien durs. Maintenant, on a du fil tout prêt, du nylon poissé et des aiguilles en acier, ça va 100 fois plus vite et c’est bien plus solide. »
23- Pierre Sussi

Pierre Sussi est né à Notre-Dame de Londres le 28 juin 1930. Il s’y marie en 1952 avec Renée, qu’il avait connue à l’école. A ce moment là, propriétaire de quelques vignes, il s’imaginait un avenir agricole sur sa commune. Mais surviennent les gelées de 1956 et adieu veau, vache, cochon, couvée ! Il fallait avoir une idée, et une bonne. Encore sans enfant, le jeune couple part pour la ville. Pierre commence comme chauffeur routier. Il va charger du vin en citerne qu’il ira livrer jusque dans la Nièvre, la Côte d’Or ou l’Allier…
C’est en 1958, à la naissance de son premier enfant, qu’il prend, sans un sou en poche, la décision de s’installer en ville comme marchand de vin. « J’ai commencé au numéro 63 du faubourg Figuerolles, à côté d’un Bon Lait (où s’est installé depuis un cordonnier). Mais on n’y est pas resté longtemps car on a eu un problème avec notre voisin. En effet, nous avions le même propriétaire, M. Saint. Ce dernier avait promis au Bon Lait que s’il louait à un autre commerçant, ce serait à quelqu’un qui ne vendrait pas les mêmes choses que lui, il l’avait écrit sur le bail. Mon prédécesseur était réparateur de vélos, tout allait bien ! A moi, il m’avait simplement dit que je ne devais pas vendre de lait. Pas de problème au début, mais quand j’ai commencé à vendre de la limonade, le Bon Lait a porté plainte. Alors, nous nous sommes installés en face, au numéro 76, et le photographe Mélis a pris notre place ».
C’est une épicerie qui cédera la place, en 1960, à notre marchand de vins et spiritueux. Curieux terme que celui de spiritueux : il s’applique à une boisson qui contient un fort pourcentage d'alcool (qui « monte à la tête », le siège de l'esprit). De l’esprit, Pierre Sussi n’en manquera pas : en 1974 il va s’installer au numéro 40 de l’avenue de Lodève, où il reprend une affaire de vente en gros et de mise en bouteilles en plus de son magasin de Figuerolles. Tout aurait pu en rester là si, en 1990, le propriétaire du local de l’avenue de Lodéve ne décédait. Ses héritiers décident alors d’y construire un immeuble et Pierre Sussi doit déménager. Comment continuer à travailler ? La réponse : « Pour remplacer les 400 mètres carrés de l’avenue de Lodève, on a fait construire, chez nous, à Notre Dame de Londres, un local de 1000 mètres carrés sur un de nos terrains. Et ce sont mes enfants qui continuent, je suis quand même très souvent avec eux et jusqu’à l’an dernier, je faisais encore les livraisons proches en poids-lourd ! » En 1996, Pierre Sussi et sa famille abandonnent définitivement le 76 faubourg Figuerolles, devenu grâce à ses soins une magnifique vitrine décorée en façade de faïences à l’honneur de la vigne, réalisées par le potier montpelliérain Paul Artus (à aller absolument voir), où s’est installée la Boutique d’Ecriture (voir page associations)

 Si aujourd’hui, son affaire prospère à Notre Dame de Londres, où il réside, Pierre Sussi se souvient avec émotion de son passé à Figuerolles : « Mes enfants ont d’abord été scolarisés à la Maternelle du Docteur Roux, qui existe toujours, puis à l’école de la rue Pagès, qui a été fermée depuis. Ils allaient au patronage et aux colonies de vacances organisées par La Maisonnée (une institution religieuse du faubourg). Moi, je livrais dans le quartier avec un triporteur à moteur (je l’ai toujours). Je faisais les livraisons gratuitement, par cagettes, à la Cité Gély, dans les petites rues, jusqu’à La Croix d’Argent, à Pasquier. Je faisais plus de recettes avec ces livraisons que ma femme au magasin ! Mais ça créait du mouvement : les gens venaient commander, payer, etc. ».
Si aujourd’hui, son affaire prospère à Notre Dame de Londres, où il réside, Pierre Sussi se souvient avec émotion de son passé à Figuerolles : « Mes enfants ont d’abord été scolarisés à la Maternelle du Docteur Roux, qui existe toujours, puis à l’école de la rue Pagès, qui a été fermée depuis. Ils allaient au patronage et aux colonies de vacances organisées par La Maisonnée (une institution religieuse du faubourg). Moi, je livrais dans le quartier avec un triporteur à moteur (je l’ai toujours). Je faisais les livraisons gratuitement, par cagettes, à la Cité Gély, dans les petites rues, jusqu’à La Croix d’Argent, à Pasquier. Je faisais plus de recettes avec ces livraisons que ma femme au magasin ! Mais ça créait du mouvement : les gens venaient commander, payer, etc. ».
Pierre Sussi a été aussi un témoin de la construction du quartier : « Au début, mes amis me disaient que j’étais fou de vouloir vendre du vin à des vignerons : il y avait des vignes tout autour : le dernier bâtiment, c’était la grande maison ! Puis, on a construit la Cité Chaptal, en 61-62. Le matin, les ouvriers me prenaient du vin, de la bière. Ensuite Beaucoup de rapatriés y ont habité. Eux étaient plus fortunés, ils m’achetaient des grands vins. Au même moment, c’est La Chamberte qui se construisait, et j’en livrais l’épicerie. Il y avait beaucoup d’épiceries à l’époque qui commandaient chez moi ! »
Et Pierre Sussi nous avoue son attachement au vin. Il le trouve aussi intéressant à vendre que des livres : « Il y a toujours quelque chose à dire autour du vin, selon sa région, son cépage. De plus, c’est un produit qui n’est pas périssable ». Alors, on fait le tour de son local. On y retrouve les fameuses bouteilles de un litre, à six étoiles, en verre, qui ont été un temps le contenant majeur, aujourd’hui en voie de disparition. Il nous explique qu’on ne trouve plus aujourd’hui de fabricant de petites capsules en métal et que les fameux BIB sous vide s’imposent peu à peu. La fin d’un temps ?
24- René Brel
Une longue route en famille

 « Je suis né le 22 février 1918 dans une petite maison, au 12 de la rue Guillaume Pellicier à Montpellier. Nous étions une famille nombreuse et nous vivions dans de petites pièces, au premier étage. Comme la rue n’était pas goudronnée mais pourtant très passagère, un grand nuage de poussière y flottait en permanence. C’était le passage des charrettes qui allaient au parc à fourrage de l’avenue d’Assas. Il y avait aussi beaucoup de transports qui allaient et venaient de la gare Chaptal. J’ai vécu là jusqu’à l’âge de 5 ans ; mon père était venu s’installer au Plan Cabanes quelques années plus tôt pour y travailler. Mon père se prénommait Honoré. Il était tonnelier et n’était jamais allé à l’école. C’était un homme si maigre que personne ne voulait l’embaucher et il s’était mis à son compte. Il était né au numéro 1 de la rue Figuerolles. C’était l’avant dernier d’une famille de onze enfants. Ma mère, Maria Gabrielle Valentin, était née à Béziers. Elle aidait sa mère qui était lavandière au 12 de la rue Guillaume Pellicier. Mes parents se sont connus en 1906, se sont mariés et ont eu six enfants.
« Je suis né le 22 février 1918 dans une petite maison, au 12 de la rue Guillaume Pellicier à Montpellier. Nous étions une famille nombreuse et nous vivions dans de petites pièces, au premier étage. Comme la rue n’était pas goudronnée mais pourtant très passagère, un grand nuage de poussière y flottait en permanence. C’était le passage des charrettes qui allaient au parc à fourrage de l’avenue d’Assas. Il y avait aussi beaucoup de transports qui allaient et venaient de la gare Chaptal. J’ai vécu là jusqu’à l’âge de 5 ans ; mon père était venu s’installer au Plan Cabanes quelques années plus tôt pour y travailler. Mon père se prénommait Honoré. Il était tonnelier et n’était jamais allé à l’école. C’était un homme si maigre que personne ne voulait l’embaucher et il s’était mis à son compte. Il était né au numéro 1 de la rue Figuerolles. C’était l’avant dernier d’une famille de onze enfants. Ma mère, Maria Gabrielle Valentin, était née à Béziers. Elle aidait sa mère qui était lavandière au 12 de la rue Guillaume Pellicier. Mes parents se sont connus en 1906, se sont mariés et ont eu six enfants.
Un de mes plus beaux souvenirs d’enfance est le trajet que me faisaient faire les ouvriers à dos de jument. Elle s’appelait Coquette. Avec elle, nous passions de la rue Pagés à la rue Guillaume Pellicier, puis nous tournions à gauche. Ensuite, on prenait le trottoir du bar de l’Intendance pour arriver au Plan Cabanes. Puis, je rentrais tranquillement à pied. J’aimais bien ça… Comme l’appartement et la tonnellerie étaient trop petits, nous avons déménagé rue Pagès. Alors, mon père est passé de la fabrication artisanale à la fabrication en série de foudres et futailles, avec les machines modernes de l’époque. Elles faisaient un bruit infernal. On enlevait chaque jour un plein camion de copeaux. En 1924, mon père a abandonné le travail avec les chevaux et s’est modernisé : il a acheté un camion Fiat de l’armée et une voiture Clément Bayard. En 1925, il a acheté un camion CBAC avec sa remorque, et l’année suivante, un Chevrolet 4T.
Les beaux jours, nous allions à la plage de Carnon. Au début, pour y aller, c’était une véritable expédition. On ne pouvait pas y accéder directement, il fallait longer la plage à pied, en passant par Palavas. On y allait en jardinière, tractée par la jument Coquette, et on l’attachait à un arbre pour passer une heure ou deux à la plage ! Il y avait un bac pour traverser le canal (avec la jardinière et Coquette…). Longtemps après, il sera remplacé par une passerelle puis par un pont en fer. Parfois, nous allions aussi passer un dimanche aux sources du Lez. Il y avait une buvette et de la musique ; c’était une guinguette agréable au bord de l’eau, bercée par le son de l’accordéon.
Je suis resté rue Pagès jusqu’à 17 ans. J’étais allé à l’école maternelle Chaptal aux Arceaux, puis à l’école Auguste Comte. J’ai arrêté l’école en 1931, à 13 ans. Je n’ai jamais manqué l’école, mais je ne l’aimais pas tellement. Je voulais travailler le plus tôt possible, pour rapporter de l’argent à mes parents. Mais petit, j’avais des dons pour le dessin. J’arrivais à bien représenter un paysage, des fleurs, une maison dans la nature, avec ou sans feuilles. J’avais plus de difficultés avec les visages. Quand je dessinais une femme nue, je réussissais bien le corps, mais on ne reconnaissait pas vraiment le visage. Ce n’était pas mon truc.
 Ma mère me voyait bien exercer le métier de peintre en lettres et voulait me placer chez un ami de mon père. Mais mon père préférait me garder avec lui et y a réussi. Le 21 juillet 1931, j’ai quitté l’école pour rejoindre l’entreprise familiale qui était spécialisée dans la tonnellerie mécanique, les foudres et les futailles et qui prenait en charge la livraison par camion et par chemin de fer. Mais au début des années trente, tout ce qui se faisait en bois commençait à se fabriquer en fer. Le vin était désormais transporté en camions-citerne. En 1934, mon frère Louis, qui avait constaté que les demandes de transport ne cessaient de croître décide de monter la première entreprise qui marque pour nous la fin de la tonnellerie».
Ma mère me voyait bien exercer le métier de peintre en lettres et voulait me placer chez un ami de mon père. Mais mon père préférait me garder avec lui et y a réussi. Le 21 juillet 1931, j’ai quitté l’école pour rejoindre l’entreprise familiale qui était spécialisée dans la tonnellerie mécanique, les foudres et les futailles et qui prenait en charge la livraison par camion et par chemin de fer. Mais au début des années trente, tout ce qui se faisait en bois commençait à se fabriquer en fer. Le vin était désormais transporté en camions-citerne. En 1934, mon frère Louis, qui avait constaté que les demandes de transport ne cessaient de croître décide de monter la première entreprise qui marque pour nous la fin de la tonnellerie».
Les poutres du musée Fabre.
En 1934 l'entreprise BREL s'est reconvertie en transport public de marchandises et 73 ans après elle est toujours en place et à la tête d’une large flotte de véhicules pour effectuer tout type de transports nationaux ou internationaux. Elle peut aussi, à l'aide de semi-remorques, exécuter des transferts d'engins de Travaux Publics (pelles mécaniques, bulldozers, etc.) ou tout autre matériel sous forme de transports exceptionnels. Encore plus fort avec la possibilité de l’utilisation de bras grues auxiliaires montés sur porteurs. Mais elle fait aussi « dans la dentelle » dirons-nous, plus délicat car elle est hautement spécialisée en manutention à main comme pour le déplacement de coffres-forts, de pianos, de chaudières, de machines outils ainsi que pour le déménagement industriel. Elle dispose pour cela de tout le matériel nécessaire aussi bien en chargement qu'en transport. L’entreprise Brel assure également le levage à l'aide de grues mobiles. Une nouveauté, elle met au service de sa clientèle un bâtiment de 1.800 m² pour le stockage. Parmi les derniers grands chantiers : le transport des rails du tramway, qui étaient entreposés aux Prés d’Arènes et amenés la nuit (entre 20h et 1h du matin) sur les chantiers pendant plus d’un an, ou encore la livraison des grandes poutres du musée Fabre, pour l’entreprise Eiffage, de nuit également, avec la police municipale et les motards…
Pour René Brel, la vie est passée à une telle rapidité qu’il n’a pas pris le temps d’avoir d’enfants : « Je me suis marié tard, le 7 mars 1970, avec Marie Rose, ma collaboratrice, dont j’étais profondément amoureux ; j’avais 52 ans et elle 25. Je me suis longtemps demandé si c’était raisonnable de se marier avec une femme qui avait presque 30 ans de moins que moi. Mais tant d’autres ont fait de même ! ». Marie-Rose est amoureuse comme au premier jour, cela s’entend dans sa voix : « Je pense qu’il m’a aimée dès qu’il m’a vue, quand j’ai commencé à travailler chez lui en 1963, dit-elle avec émotion. C’est un homme incroyablement agréable, gentil, attentionné. S’ils étaient tous comme lui, je pense qu’il n’y aurait jamais de divorce ». Et elle évoque les meilleurs souvenirs d’une vie où le travail était toujours présent en filigrane. Leur voyage de noces en Espagne et au Portugal était aussi l’occasion de vérifier l’état des routes afin d’y faire transiter des métiers à tisser depuis l’Allemagne ; pour le Maroc en 1975 c’était aussi l’occasion de préparer le convoyage d’un chalet destiné au palais du roi Hassan II, celui en Corse c’était le transport de deux réservoirs de 35 m chacun, embarqués dans le ferry à Marseille. Marie-Rose se souvient d’une anecdote ; c’est quand le capitaine du ferry lui a présenté l’endroit ou elle devrait coucher, un dortoir où il n’y avait que des hommes. « Le capitaine attendait ma réaction. Moi, ça ne me gênait pas, j’aurais dormi n’importe où. Mais il nous a généreusement laissé sa cabine, sans qu’on ne lui ait rien demandé. » Parmi les choses qui ont rendu Marie-Rose amoureuse, nous explique-t-elle, il y a l’humanisme de René : « Quand un ouvrier faisait une bêtise, il ne le condamnait jamais ; il essayait toujours de comprendre » ; il y a aussi sa confiance et sa tolérance : « Je sais que je compte beaucoup pour lui, mais dans le même temps il me laisse une totale liberté pour tous mes engagements associatifs ».
Lire ici l'article paru dans l'Hérault du Jour le 16 mars 2014.
Lire ici l'article paru dans le Midi Libre le 19 mars 2014
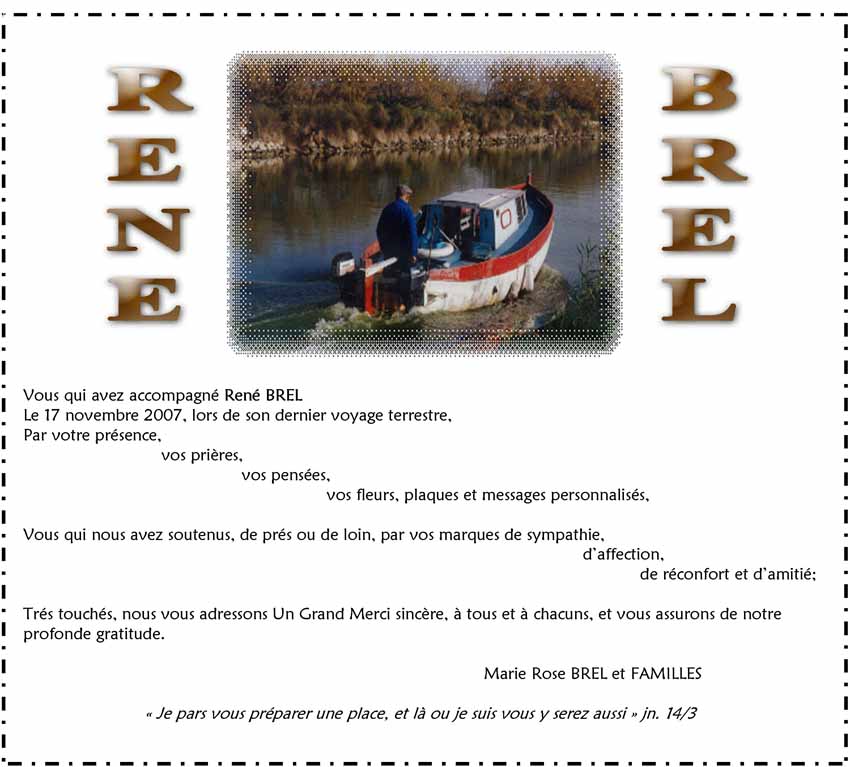
25- Robert Durand
 « Je suis né en 1923 aux Arceaux. Quand j’avais dix ans, on est venu s’installer à Figuerolles, 16, rue Saint Antoine. Mon père fabriquait du tartre. On en faisait beaucoup à l’époque. Moi, à 15 ans, j’ai commencé à travailler aux chemins de fer de l’Hérault. J’étais à l’atelier de la gare Chaptal. C’était tout près. Mais je travaillais là par force, et j’y faisais ce qu’on me demandait de faire, c’est tout. Un patron qui décidait, qui commandait, ça me gênait. Et j’ai pris ma retraite très tôt. J’avais rêvé d’être vagabond : me promener, à droite, à gauche. Il y en avait un dans ma famille et je l’admirai, j’avais envie de faire comme lui, mais mes parents n’ont pas voulu. C’était ça la vraie vie, la sienne . Puis, j’ai eu un vélo. Pendant les congés, je partais. Je suis allé en Espagne, en Suisse, à Paris. Je couchais dehors. J’ai peint aussi ; j’ai appris tout seul en regardant mon père. (et Robert Durand me présente des tableaux extraordinaires). Là, c’est une roulotte dans une rue, pas très loin. Je ne me souviens plus de son nom mais je sais comment y aller. Là, c’est le Pic Saint Loup. J’y allais souvent. Et voilà la famille Cornier, qui habitait en face, au rez-de-chaussée. Ils n’ont jamais su qu’ils étaient là. Et sur ce tableau, je ne me souviens plus qui c’était (je découvre une superbe femme, Marianne au regard énigmatique, les seins nus dans un décor floral). Aujourd’hui, je ne dessine plus. Je me promène dans les rues de la ville, à pied. Je ne prends jamais le bus. Je décide de ma destination comme je veux. Quand il se passe quelque chose dans le quartier, j’y vais. Je n’ai pas la télé, je ne lis pas le journal. J’écoute les informations à la radio. Cette maison est à moi, j’y suis très bien. »
« Je suis né en 1923 aux Arceaux. Quand j’avais dix ans, on est venu s’installer à Figuerolles, 16, rue Saint Antoine. Mon père fabriquait du tartre. On en faisait beaucoup à l’époque. Moi, à 15 ans, j’ai commencé à travailler aux chemins de fer de l’Hérault. J’étais à l’atelier de la gare Chaptal. C’était tout près. Mais je travaillais là par force, et j’y faisais ce qu’on me demandait de faire, c’est tout. Un patron qui décidait, qui commandait, ça me gênait. Et j’ai pris ma retraite très tôt. J’avais rêvé d’être vagabond : me promener, à droite, à gauche. Il y en avait un dans ma famille et je l’admirai, j’avais envie de faire comme lui, mais mes parents n’ont pas voulu. C’était ça la vraie vie, la sienne . Puis, j’ai eu un vélo. Pendant les congés, je partais. Je suis allé en Espagne, en Suisse, à Paris. Je couchais dehors. J’ai peint aussi ; j’ai appris tout seul en regardant mon père. (et Robert Durand me présente des tableaux extraordinaires). Là, c’est une roulotte dans une rue, pas très loin. Je ne me souviens plus de son nom mais je sais comment y aller. Là, c’est le Pic Saint Loup. J’y allais souvent. Et voilà la famille Cornier, qui habitait en face, au rez-de-chaussée. Ils n’ont jamais su qu’ils étaient là. Et sur ce tableau, je ne me souviens plus qui c’était (je découvre une superbe femme, Marianne au regard énigmatique, les seins nus dans un décor floral). Aujourd’hui, je ne dessine plus. Je me promène dans les rues de la ville, à pied. Je ne prends jamais le bus. Je décide de ma destination comme je veux. Quand il se passe quelque chose dans le quartier, j’y vais. Je n’ai pas la télé, je ne lis pas le journal. J’écoute les informations à la radio. Cette maison est à moi, j’y suis très bien. »
26- Tané Farré
 « Je suis né à Montpellier en 1935. On était cinq dans la famille. J’habite toujours au faubourg Figuerolles. J’ai commencé par être soldeur sur les marchés. Avant, mes parents étaient des voyageurs, ils vendaient des draps de lit, des couvertures. Mon père avait vécu en Espagne. Mais ma passion, c’est la boxe. Je m’entraînais avec Hippolyte Annex, (qui sera plus tard champion de France), jusqu’au grave accident de voiture qu’on a eu en 1953 dans lequel notre entraîneur, Léon Capman, a trouvé la mort. Il me fallait aller boxer à Béziers pour pouvoir continuer. A cause des trajets, j’ai arrêté ma carrière, mais j’ai continué à boxer comme entraîneur bénévole pour les jeunes, pour les sortir de là. J’ai fini par obtenir la création de la salle de boxe à la cité Gély.
« Je suis né à Montpellier en 1935. On était cinq dans la famille. J’habite toujours au faubourg Figuerolles. J’ai commencé par être soldeur sur les marchés. Avant, mes parents étaient des voyageurs, ils vendaient des draps de lit, des couvertures. Mon père avait vécu en Espagne. Mais ma passion, c’est la boxe. Je m’entraînais avec Hippolyte Annex, (qui sera plus tard champion de France), jusqu’au grave accident de voiture qu’on a eu en 1953 dans lequel notre entraîneur, Léon Capman, a trouvé la mort. Il me fallait aller boxer à Béziers pour pouvoir continuer. A cause des trajets, j’ai arrêté ma carrière, mais j’ai continué à boxer comme entraîneur bénévole pour les jeunes, pour les sortir de là. J’ai fini par obtenir la création de la salle de boxe à la cité Gély.
J’ai été le président de toute la communauté gitane de Montpellier. J’ai arrêté il y a 4 ou 5 ans, maintenant je suis à la retraite. Avec mon ami Mario Marcou, on essayait de régler les problèmes des gitans. La mairie nous avait engagés comme employés municipaux. On intervenait dans les écoles à la demande des instituteurs quand il y avait des histoires, dans les quartiers quand il y avait des bagarres, on ramenait le calme comme on pouvait. On avait un bureau et on touchait une subvention de la mairie ; à peu près 2300 € par an qu’on utilisait surtout pour aider ceux qui n’arrivaient pas à payer leur loyer ou l’électricité, mais c’était vite parti. On aidait aussi les gens à trouver du travail, comme employés municipaux ou chez Nicollin. On intervenait également pour qu’ils obtiennent un logement, comme à la cité Gély. Aujourd’hui, il n’y a plus une seule personne qui représente toute la communauté. Ce travail est fait par plusieurs associations dont les présidents sont reçus en mairie quand ils le demandent.
Notre ancienne tradition du pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer a énormément perdu de sens. Jadis, c’était très beau. Tout le midi s’y retrouvait. Narbonne, Perpignan, Béziers, Arles, Avignon, Sète, Tarascon… Aujourd’hui, l’esprit n’y est plus, il y a des bagarres, les cafés ferment à 6 heures du soir. Avant, tout le monde chantait, les filles dansaient, c’était du bonheur. Il faut dire aussi que de plus en plus de gitans sont « évangélistes de Dieu » ; ils prient plutôt le bon Dieu que les saints, donc ils ne vont pas au pèlerinage. En ce qui me concerne, de toute façon, je ne suis pas pratiquant. Quand on pratique quelque chose, il faut le faire sérieusement, et moi, j’aime bien trop m’amuser, je ne pourrais pas suivre les règles de la religion… »
27- Julien Del Litto
Julien Del Litto est domicilié rue du Père Fabre, au cœur du quartier Figuerolles à Montpellier. Depuis 3 ans, il s’est installé professionnellement à deux pas de chez lui, rue Legendre Hérail, dans un atelier pas ordinaire. Il y fabrique de curieux objets en silicone à la fois luminescents et translucides qui ne manquent pas d’étonner plus d’un passant. Lampes, vases, cendriers, méticuleusement emballés, s’alignent sur des étagères. Des hiboux, des lapins, de petits éléphants et des créations originales peuvent ainsi être illuminés de l’intérieur. Surprenant et magnifique travail qui est allé jusqu’à séduire le MoMA (Museum of Modern Art de New York), le salon Maison et Objets, ou encore le Musée des Arts Décoratifs de Paris. Rencontre avec un artiste créateur surprenant.

Ce sera au lycée du Mas de Tesse que Julien Del Litto prendra la décision de s’orienter vers un CAP de dessinateur en publicité. Deux ans de formation à Paris qui se terminent par des stages en entreprise. Peu séduit par les stratégies de communication en marketing qui lui sont proposées, il décide de rectifier le tir tout en restant dans son domaine de prédilection, la création artistique. C’est dans la Drôme, à l’École Régionale des Beaux-arts, qu’il s’inscrira alors pour une formation qui durera cinq ans. Ce qu’il préfère, c’est la peinture : « J’ai réalisé une importante série de tableaux qu’il faudra que j’expose un jour, mais je dois d’abord trouver un endroit qui me convienne… »
Quand on l’interroge sur ses créations actuelles, Julien Del Litto nous explique qu’il y est arrivé un peu par hasard : « J’avais récupéré un ancien tube en terre cuite, datant vraisemblablement du moyen âge. J’ai décidé de le recouvrir de silicone, que j’ai laissé sécher. Le silicone ne sèche qu’au contact de l’air : si on en enduit une vitre, seul l’extérieur séchera, mais ce qui est au contact de la vitre reste adhésif, on ne peut pas l’enlever facilement. Sur la terre cuite, qui est poreuse, les deux côtés ont séché, j’ai donc ensuite pu démouler facilement mon tube. J’avais ainsi créé une copie souple de mon tuyau ». Intéressé par le résultat, Julien Del Litto va concevoir des moules en plâtre, de diverses formes. Il va colorer son silicone (du silicone translucide neutre en tube du commerce), en y mélangeant des colorants universels et créer ainsi divers objets en recouvrant ses moules d’une couche uniforme de silicone lissé à la spatule puis lustré à l’essence F. Quand c’est sec, il démoule et voilà.
Une fois par semaine, Julien Del Litto se consacre à sa passion profonde, la peinture. Il nous explique la raison essentielle de son artisanat : « Aujourd’hui, un artiste ne peut pas vivre de son art ; il lui faut exercer une profession supplémentaire, généralement, c’est l’enseignement ». Pour lui, mission impossible. « Je ne peux absolument pas faire ce métier, même avec des enfants, j’ai essayé, cela m’ennuie, il me fallait trouver autre chose ». Et il trouve : le voilà devenu artisan, répertorié à la Chambre des Métiers. « J’aurais pu m’inscrire à la Maison des Artistes ; c’était plus avantageux sur le plan fiscal, mais un créateur ne peut produire qu’un petit nombre de copies (une quinzaine) de chacune de ses œuvres, en les numérotant. Moi j’ai des commandes de l’ordre de 200 à 300 pièces identiques ; je suis donc vraiment devenu un artisan créateur ».

A Montpellier, il fournit les établissement Boudard ; sur le plan national, des groupes tels les Galeries Lafayette, Bon Marché ou le Printemps. Julien Del Litto a des clients dans de nombreux pays, retrouve ses objets sur des catalogues édités par ses revendeurs aux quatre coins du monde. « L’incroyable, nous dit-il avec malice, c’est que j’arrive à en faire vivre les miens sans me compromettre ! ». Et il n’est pas peu fier de sa petite famille, d’abord de ses trois enfants qui ont deux ans d’intervalle : « C’est très bien comme ça, quand j’achète un vélo au premier, il sera ensuite utilisé par le second, puis le troisième, et c’est comme ça pour tout ». Il nous parle ensuite de son épouse qu’il a rencontrée à Lyon. « Elle est couturière depuis 1993 place Ste Anne à Montpellier ; elle conçoit des robes sur mesure, pour les mariages, pour le conservatoire ». Julien Del Litto ajoute à tout cela un engagement bénévole : il est animateur à « L'Eko des Garrigues », une radio associative (dont il est le trésorier) non commerciale « alternative et d'avant-garde » (sur 88.5 FM).
Au sujet de son entreprise, Julien Del Litto envisage de se renouveler. « Maintenant, il me faut trouver une nouvelle idée. Tiens, finalement pourquoi pas me faire salarier dans un autre secteur. Entretenir les espaces verts de la ville, par exemple ». Humour ou provocation ? Allez donc lui poser la question, cela en vaut la peine.
Contact : Julien Del Litto, créateur-fabricant, 8 rue Legendre Hérail, 34070 Montpellier. Tel : 04 67 56 04 08. Sur le net : fiatlux34@yahoo.fr
28- Le Père Bonnet

Celui qui sera surnommé l'apôtre de Figuerolles est né à Capestang en 1870. Il sera ordonné prêtre en 1893, occupera divers postes et c'est en 1917 qu'il sera nommé par le Cardinal de Cabrières Chapelain de l'Immaculée Conception. Il va ainsi confirmer l'apostolat commencé dans le faubourg Figuerolles en équipe avec le père Fabre dès 1908. Il jouissait d'une grande popularité dans le quartier, n'hésitait pas à aller frapper à la porte des plus riches pour obtenir de quoi nourrir les pauvres. A 80 ans, il subit une grave opération, et finit ses jours à la Sainte Famille. A ses obsèques, en 1955, son corps sera porté à travers les rues de Figuerolles en une immense procession. Son nom sera donné à la rue dans laquelle se trouve la chapelle de l'Immaculée Conception ainsi qu'au square qui se trouve à l'angle de cette rue et du faubourg Figuerolles..
29- L'Abbé Coursindel.

Né en 1904 à Mauguio, il sera ordonné en 1934 à l'église Sainte Eulalie (rue de la Merci à Montpellier). Iil sera mobilisé en 1939, blessé et prisonnier de guerre. Il va ensuite consacrer son ministère à l’aumônerie dans le monde du travail : déjà aumônier diocésain adjoint de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), J.O.C.F. et L.O.C en 1942, puis dans le monde agricole : J.A.C., L.A.C.F. et L.A.C en 1944. Il est nommé ensuite chanoine de la basilique cathédrale de Montpellier, au retour des prêtres prisonniers, en septembre 1945. En 1950, il devient l'adjoint du père Bonnet et à sa mort, en 1955, il sera nommé curé de la paroisse de Notre Dame de la Paix, qui incluait Figuerolles. Ensuite, la paroisse sera scindée en deux. Lui sera nommé curé de la paroisse Immaculée Conception. Il est victime d'un accident de la route, le 29 avril 1964 : " C'était un matin, vers 7 h 30, se déplaçant en mobylette vers Villeneuve-les-Maguelonne, se trouvant entre le château de la Lauze et le relais de Terreneuve, que l'abbé fut heurté par une voiture de marque Peugeot 404. C'est en voulant doubler que le véhicule accrocha la mobylette de l'abbé. Sous la violence du choc, le pauvre homme décéda sur le coup. Une chapelle ardente fut dressée dans le modeste presbytère de N.D. de la Paix, à Figuerolles-le-haut ". Personnage très aimé en raison de son investissement, de son charisme et de sa générosité, ses funérailles rassemblérent une foule immense. Son nom sera donné au petit square situé entre la rue St Antoine et la rue Pierre Fermaud (square malheureusement promis aujourd'hui -2017- à un projet immobilier).
30- Lojka Mitrovic

A Montpellier, le quartier des Saints est relativement peu cité dans les divers agendas et programme de visites de notre ville. Pourtant, c’est un véritable petit trésor, qui a son identité propre, ses traditions : un document tout à fait officiel de la ville de Montpellier (cf page accueil), destiné à délimiter des Zones de Protection du Paysage Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) en fait la présentation suivante : « Le Quartier des Saints, dont la typologie de maisonnettes abrite un ou deux logements, contribue à des usages que l’on pourrait qualifier de méditerranéens et où l’espace public y est annexé par ses habitants. Dans ce quartier modeste, où l’artisanat était relativement présent, ces quelques rues conservent à la fois les usages et les modes de vies qui s’y sont développés ». En ces journées du Patrimoine, il vous faut donc profiter du beau temps ( ?) pour visiter un endroit ignoré jusqu’alors, l’Hérault du Jour à la main.
C’est au travers du témoignage d’un de ses acteurs, le menuisier Lojka Mitrovic, que nous allons y vivre un instant. Nous allons faire comme lui et bien d’autres, des gens d’ici et d’ailleurs, ou ni vraiment d’ici, ni vraiment d’ailleurs, mais qui sont devenus des résidents pour un temps ou pour toujours du petit quartier des Saints. Lojka Mitrovic est né en 1952 à Kursumlija, une petite ville de Serbie du district de Toplica. Venu rejoindre son frère, c’est son art du football et son aptitude au sport de haut niveau qui, à vingt ans, vont le faire rester en France, à Aurillac dans le Cantal. Son poste sur le terrain, c’était le numéro cinq, celui que l’on nomme le libéro. En complément, il trouvera du travail sur place dans une usine de meubles. Par la suite, il sera invité par son patron au Cap d’Agde, y passer quelques week-end. Mais les choses ne s’arrêtent pas là car les affaires vont aller bon train. Nos menuisiers décrochent des chantiers sur place et de fil en aiguille, Lojka Mitrovic devient un véritable montpelliérain.
C’est avec son patron, Jean Alba, que commence la carrière de menuisier de Lojka Mitrovic, il y a 30 ans, 10 rue de Metz, au cœur du quartier des Saints, dans un atelier qui existait déjà depuis longtemps. « Au début, on travaillait beaucoup pour le pétrole, pour l’entreprise UIE du chemin de Moularés, nous explique Lojka. On fabriquait du matériel pour les plates-formes. Il fallait que ça tienne le coup. On utilisait beaucoup le peuplier qui résiste bien parce qu’il est flexible. On travaillait aussi pour les forages, dans le désert ; là aussi, il fallait que ce soit à toute épreuve ». C’est arrivé à l’âge de soixante-dix ans, en 1996, que Jean Alba décide de céder l’affaire à son employé. « Aujourd’hui, je ne fabrique plus beaucoup. Je pose des menuiseries industrielles, mais attention, pas n’importe lesquelles et je fais de l’agencement de cuisines, de magasins, des placards. Encore quelques restaurations de meubles, mais peu. J’ai beaucoup de travail dans les quartiers du centre ville où il est obligatoire de poser des menuiseries en bois. Le bois, c’est beaucoup mieux que les nouveaux matériaux. Bien plus isolant et si c’est du bon résineux, du Nord rouge, c’est presque éternel ! ».

« Le quartier des Saints, à mes débuts, était peuplé d’artisans, nous explique Lojka en nous promenant dans les rues. Juste à côté, un mécanicien, Manogil ; en bas de la rue de Metz, sur la petite place, un autre menuisier ; juste en face de nous, dans l’ancienne épicerie Lacoste, c’était du matériel pour boulangerie ; plus haut, il y avait Merciéca, le carrossier ; Tarral le peintre, au numéro 16 ; Alain Vaillant, le spécialiste en chaudières au 23 ; Omnium Chauffage, rue Haguenot : un vrai spécialiste où on venait de toute la ville chercher du matériel de plomberie ; Alain, le peintre en lettres, rue du Père Fabre. Il y avait bien 5 ou 6 menuisiers dans le quartier, comme Claude Lavezac, rue Pagés. Et tous travaillaient beaucoup ». C’était le Bar des Lilas, place Bouschet de Bernard, et le restaurant voisin, Le Renouvier, qui étaient alors le QG de toute cette fine équipe.
C’est il y a une vingtaine d’années, que peu à peu, les artisans ont quitté le quartier. Les habitudes ont changé, il est devenu très difficile de se garer, d’autres besoins se sont faits sentir. Ce qui émerge aujourd’hui comme traces, c’est le foisonnement associatif, visible au moins sur les boîtes aux lettres, ce sont les ateliers d’art (Ecole Brousse, Atelier du Nord, etc.), les animations alternatives genre couscous de rue ou partie de pétanque (tiens, il y aura un marché aux puces le dimanche 5 octobre rue du Père Fabre), la persistance de cette tradition de vie sociale en commun qui régule autant que faire se peut les dérives des uns et des autres.
31- Pascal Moisset, Century 21
Natif du Nord-Aveyron, Pascal Moisset est un professionnel de l’immobilier. Son BTS comptabilité-gestion d’entreprises en poche, il commence à exercer dès 1990 en région parisienne, comme collaborateur au sein d’agences. C’est en 1996 qu’il intègre le groupe Century 21. En 2000, il achète l’agence immobilière du même nom sise 14 boulevard Renouvier à Montpellier : « Le label Century 21 (Eurogestrim), avec ses 950 agences en France, est une franchise, nous explique-t-il ; nous achetons le droit d’image pour exercer sous cette enseigne. De plus, nous bénéficions de sa notoriété et de ses énormes moyens de promotion (Télévision, Internet, journaux professionnels, etc.) ». Pascal Moisset saura développer son affaire en créant de l’emploi et en ouvrant deux autres agences : 6 collaborateurs travaillent avec lui Bd Renouvier ; 5 autres dans une deuxième agence à Lattes et 5 de plus à Mauguio.
 Pascal Moisset nous explique que chacune de ses agences est une agence de proximité, qui fonctionne avec son territoire : « Nous voulons être connus et reconnus sur notre secteur ; nous allons à la rencontre des gens : il n’y a rien de mieux que d’aller voir quelqu’un chez lui. Les services que nous offrons sont la transaction, la location et la gestion de biens (nous trouvons le locataire et nous occupons de tout) ». Vient bien sûr la question du territoire, de son évolution, de ses transformations qui en font un terrain spécifique et évolutif : « Le quartier où nous sommes, Figuerolles et ses alentours, connaît de grands changements. L’opération Grand Cœur a entrepris une importante rénovation du quartier en rachetant des immeubles, en aidant les propriétaires à ravaler les façades, à refaire les cages d’escalier. Tout ceci améliore l’image générale de l’habitat et le quotidien de tous ceux qui y demeurent ».
Pascal Moisset nous explique que chacune de ses agences est une agence de proximité, qui fonctionne avec son territoire : « Nous voulons être connus et reconnus sur notre secteur ; nous allons à la rencontre des gens : il n’y a rien de mieux que d’aller voir quelqu’un chez lui. Les services que nous offrons sont la transaction, la location et la gestion de biens (nous trouvons le locataire et nous occupons de tout) ». Vient bien sûr la question du territoire, de son évolution, de ses transformations qui en font un terrain spécifique et évolutif : « Le quartier où nous sommes, Figuerolles et ses alentours, connaît de grands changements. L’opération Grand Cœur a entrepris une importante rénovation du quartier en rachetant des immeubles, en aidant les propriétaires à ravaler les façades, à refaire les cages d’escalier. Tout ceci améliore l’image générale de l’habitat et le quotidien de tous ceux qui y demeurent ».
En réponse aux protestations que l’on peut entendre ici où là (voir photo) au sujet des préemptions effectuées par la SERM sur les ventes en cours, Pascal Moisset est rassurant : « Ce qui est racheté, en fait, ce sont des appartements insalubres dans des immeubles souvent en mauvais état, ou des immeubles complets en très mauvais état, loués dans de mauvaises conditions. Quand nous avons à la vente des logements de ce type, la SERM nous contacte afin que nous lui fassions visiter ces biens. Toutefois, dans ce type de cas, j’ai vu des ventes se faire sans préemption après que le futur propriétaire se soit engagé, avec un projet bien ficelé, à rénover son acquisition selon les règles. Pour donner un chiffre, nous avons en moyenne deux préemptions pour 50 à 60 affaires conclues dans notre agence ».

Maison Tarral, 16 rue de Metz
L’arrivée annoncée du tramway Cours Gambetta s’ajoute à l’attrait qu’exerce ce quartier sur un certain public, nous explique Pascal Moisset. Ce public certain est, depuis dix ans, un public plutôt jeune : « Les prix sont plus abordables qu’à Boutonnet ou aux Beaux-Arts ; le centre ville est à deux pas ». Toutefois, estime-t-il, « les prix n’augmenteront pas : en 7 ans, ils avaient doublé ! La tendance est vraiment à la baisse, au rééquilibrage. Les ventes ne se font plus aussi vite qu’avant et demandent de 2 à 6 mois de prospection si le vendeur est réactif, c’est à dire s’il sait adapter son prix aux cours du marché actuel ». Et les affaires continuent : « S’il y a 25 pour cent de transactions en moins, certes, la crise annoncée dans les médias n’est pas si grave : les prêts sont toujours accordés, même si les taux sont plus élevés et si les banques demandent un apport personnel plus important. Les prêts relais sont plus difficiles à obtenir parce que le montant estimé de la vente d’un bien n’est pas le montant obtenu à la vente. Il est plus prudent d’attendre d’avoir vendu pour acheter, ce que se résignent à faire les clients actuels ». Pascal Moisset nous signale également le recul, depuis six mois, des acheteurs étrangers de l’Europe du Nord, recul qui va jusqu’à la mise en vente de biens y compris dans l’arrière pays. Par contre, l’attrait du soleil s’exerce toujours fortement pour les gens du centre et du nord de la France, surtout les retraités : « On est l’endroit le moins cher de la côte… Au final et contrairement à ce qui est parfois avancé, cette zone est occupée par une population très similaire à celle qui occupe les autres quartiers de la ville ».
Il nous restait à demander à Pascal Moisset pourquoi plus de la moitié des transactions et des locations sont confiées à des agences du type de la sienne : « Nous offrons un conseil, une analyse comparative du marché, un accompagnement personnalisé et juridique. Nous avons de véritables acheteurs, titulaires d’un budget, qui ne sont pas de simples curieux. Les visites sont accompagnées, nous ne faisons pas entrer n’importe qui chez le vendeur, c’est ça la différence ».
Contact : 14 bd Renouvier 34000 Montpellier. Tel. 04 67 06 13 00 ;
E-mail : ag750@century21france.fr; Internet : www.century21.fr
32- Dari Boumédienne
Quand les bouchers ont des secrets de famille qui mettent l’eau à la bouche, il faut ouvrir le four en grand !

Le plaisir de la chair et de la bonne chère
Figuerolles, à Montpellier, ne manque pas de trésors. Mais comment ce quartier arrive-t-il ainsi à collectionner les personnages emblématiques, les artisans exceptionnels, les artistes de talents et les surdoués de tous poils ? C’est là qu’est le mystère. Il faut croire que tout le monde y met du sien, parce qu’il a fini par s’y créer une sorte de champ magnétique, ou plutôt, y règne une curieuse loi de la gravitation universelle… Nous présentons cette semaine une institution qui pour beaucoup ne serait pas à présenter tant sa renommée est grande. En effet, comme c’est déjà le cas pour beaucoup d’autres commerçants, nous voilà face à une échoppe qui est fréquentée par des gens du quartier, certes, mais aussi par des clients qui viennent parfois, étonnamment, de fort loin. Mais son propriétaire veut rester discret et modeste, soucieux de n’occuper que la place qui lui revient et de ne faire ombrage à personne.

Nous sommes donc rue Figuerolles ; une rue qui donne naissance au faubourg du même nom. Il y a là une boucherie halal, qui attire l’attention pour deux raisons : la richesse de son étal mais aussi la queue qui s’y forme régulièrement jusque parfois loin dans la rue. On se dit immédiatement que la viande ne doit pas être ici seulement belle et appétissante, mais que vu le public qui s’y presse, elle doit être aussi fort bonne. Il y a des endroits où faire la queue est ennuyeux, tout le monde en convient, mais ici, c’est différent ; on ne voit pas passer le temps. Tout d’abord parce que tout le monde finit par se parler, soit parce que les gens se connaissent, soit parce qu’il est difficile de résister à la bonne humeur ambiante. Il faut dire que les serveurs y sont pour beaucoup : toujours le mot pour rire, le bon trait d’humour qui détend l’atmosphère. Alors soit on participe, soit on écoute avec délectation les perles en tous genres que la bonne ambiance génère.
 Le patron, ici, s’appelle M. Dari Boumediene. Un personnage, une fois de plus, qui est presque un monument historique : « Je suis ici depuis 17 ans, nous confie-t-il ; mais avant, j’avais travaillé 20 ans dans la boucherie de M. Bensoussan, rue de la Valfère. Quand il a pris sa retraite, j’ai décidé de m’installer quelque part, à mon compte. J’avais toujours aimé ce quartier. C’est un « quartier ambiance », commerçant, avec des gens, du passage. Il s’y passe toujours quelque chose. En y venant, je ne me suis pas trompé : c’est un grand succès ». Ce qui est vraiment magique, c’est de voir l’incomparable habileté de notre boucher dès qu’il a une pièce de viande et un couteau entre les mains. Tout va à cent à l’heure, c’est tranché, désossé, paré en un tour de main… Quelle expérience ! « J’achète mes bêtes directement à un chevillard. Des animaux nés, élevés et abattus en France que je choisis personnellement. C’est leur qualité qui m’assure cette clientèle, qui me la fidélise. Je reçois les carcasses entières et je les prépare moi-même ».
Le patron, ici, s’appelle M. Dari Boumediene. Un personnage, une fois de plus, qui est presque un monument historique : « Je suis ici depuis 17 ans, nous confie-t-il ; mais avant, j’avais travaillé 20 ans dans la boucherie de M. Bensoussan, rue de la Valfère. Quand il a pris sa retraite, j’ai décidé de m’installer quelque part, à mon compte. J’avais toujours aimé ce quartier. C’est un « quartier ambiance », commerçant, avec des gens, du passage. Il s’y passe toujours quelque chose. En y venant, je ne me suis pas trompé : c’est un grand succès ». Ce qui est vraiment magique, c’est de voir l’incomparable habileté de notre boucher dès qu’il a une pièce de viande et un couteau entre les mains. Tout va à cent à l’heure, c’est tranché, désossé, paré en un tour de main… Quelle expérience ! « J’achète mes bêtes directement à un chevillard. Des animaux nés, élevés et abattus en France que je choisis personnellement. C’est leur qualité qui m’assure cette clientèle, qui me la fidélise. Je reçois les carcasses entières et je les prépare moi-même ».

Dari Boumediene me conduit vers son atelier de découpe, dans lequel je rentre sur la pointe des pieds tant y règne un ordre impeccable. J’ai un peu l’impression d’être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Dans la chambre froide, contiguë, s’alignent suspendus, les morceaux de viande apprêtés et classés selon l’animal dont ils proviennent, bœuf, agneau, volailles. Viande à rôtir, à mijoter, à braiser et je vous laisse en trouver d’autres. L’eau m’en vient à la bouche, en bon carnivore que je suis. Mais en plus, il y a ici de vrais secrets de fabrication, inimitables. Vous pouvez par exemple commander un poulet farci. Si vous ne connaissez pas, je vous assure, vous serez surpris. C’est excellent. Plus simple et tout autant secret : la kefta, une viande hachée épicée, ou tout simplement les merguez. Mais vous n’en saurez pas plus sur la fabrication, c’est un secret de famille, qui ne se transmet que de père en fils et ne se découvre que dans l’assiette. Donc acte.

Il nous reste une dernière explication à obtenir, au sujet de la viande halal. M. Dari Boumediene nous explique : « Pour nous, il ne doit pas rester de sang dans le corps de l’animal. Les bêtes sont toujours toutes saignées selon la coutume musulmane et sacrifiées par un religieux musulman, quelqu’un qui pratique et respecte les règles de l’Islam. Par exemple, moi, je suis habilité pour le faire et je l’ai fait très souvent. J’ai même officié jadis aux anciens abattoirs qui se trouvaient dans ce que l’on appelle maintenant le quartier des Beaux-Arts depuis les années 80 ». C’est que notre boucher est né en 1953, et c’est en 1972 qu’il a commencé à exercer son métier. Aujourd’hui, c’est pas moins de sept personnes qui travaillent avec lui rue Figuerolles. Toute une petite famille très fréquentable, unie pour le meilleur de nos repas les plus carnassiers…
Contact : Boucherie Dari Boumediene, 13 rue du faubourg Figuerolles, Montpellier. Tel. 04 67 92 34 21
33- Madame Plume d'or
 Madame Plume d’Or est née le 6 janvier 1922. Eliane Cardonnet, car c’est d’elle qu’il s’agit, a été ainsi surnommée par ses anciens clients qui l’apostrophent amicalement de la sorte quand ils la croisent dans les rues du quartier Figuerolles. Aujourd’hui, Madame Plume d’Or fait encore ses promenades, tous les après-midis, en compagnie de la jeune et dévouée Emilie, qui l’accompagne dans les rues. Le quartier des Saints et le Parc de la Guirlande sont ses lieux préférés. Le quartier des Saints avec la célèbre Rue Saint Antoine, celle là même qui a vu naître Eliane Cardonnet, il y a aujourd’hui… 87 ans et le Parc de la Guirlande, « un lieu remarquablement reposant, avec son buffet d’eau, son cadre de verdure et ses allées fleuries », nous explique-t-elle.
Madame Plume d’Or est née le 6 janvier 1922. Eliane Cardonnet, car c’est d’elle qu’il s’agit, a été ainsi surnommée par ses anciens clients qui l’apostrophent amicalement de la sorte quand ils la croisent dans les rues du quartier Figuerolles. Aujourd’hui, Madame Plume d’Or fait encore ses promenades, tous les après-midis, en compagnie de la jeune et dévouée Emilie, qui l’accompagne dans les rues. Le quartier des Saints et le Parc de la Guirlande sont ses lieux préférés. Le quartier des Saints avec la célèbre Rue Saint Antoine, celle là même qui a vu naître Eliane Cardonnet, il y a aujourd’hui… 87 ans et le Parc de la Guirlande, « un lieu remarquablement reposant, avec son buffet d’eau, son cadre de verdure et ses allées fleuries », nous explique-t-elle.

Mais alors, pourquoi ce surnom ? Explications, de la bouche même de la surnommée : « La Plume d’Or, c’était une librairie-Papeterie que j’ai créée dans le faubourg Figuerolles parce que je voulais que mes enfants puissent faire des études, je voulais pouvoir les leur payer. Aujourd’hui, cette boutique est devenue un taxiphone, mais le propriétaire a laissé sur la porte d’entrée, qui est vitrée, la poignée, en forme de plume d’or, que j’avais faite faire spécialement ». Magique, non ? Il fallait savoir que cette Plume d’Or existait toujours, porteuse de toute cette belle histoire, précieux objet de mémoire passé entre tant de mains…
Mais alors, vos enfants, Madame Cardonnet, que sont-ils devenus ? « J’en suis très fière : mon fils Gérard occupait un poste important à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard (il est à la retraite depuis peu), ma fille Muguette est orthophoniste à Montpellier, mon autre fille Marie est professeur agrégée de physique chimie, et j’ai encore une autre fille, Evelyne qui construit sa maison dans les Pyrénées. Ils ont tous très bien réussi ; j’ai eu quatre enfants et maintenant j’en suis à sept petits enfants ! ».

Eliane Cardonnet rassemble alors ses souvenirs personnels, dispersés par le temps et les épreuves, pour nous parler de sa vie, des différentes périodes qu’elle a traversées : « Quand j’étais jeune, j’aidais ma mère à porter le pain chez les gens qui en avaient commandé. On allait le chercher à la boulangerie de la place Salengro chez Mme Peyre, boulangerie qui existe toujours, à côté de la poissonnerie La Pêcherie, et je l’aidais à pousser la voiturette.. Puis, j’ai travaillé à la pharmacie populaire, avant d’avoir un poste de secrétaire à la caserne Grossetti (le couvent des Ursulines). Ensuite, j’ai travaillé longtemps à la fonderie montpelliéraine qui se trouvait là ou s’est établi Epsedance, au numéro 54 du faubourg Figuerolles, dans une petite impasse juste avant le pont en montant à droite. Il y avait là beaucoup d’ouvriers qui travaillaient la fonte. Ils fabriquaient des bouches d’égout. Il paraît qu’on en voit encore sur les trottoirs, dans les rues. Moi, je travaillais à l’étage, dans les bureaux, comme secrétaire.

Mon nom de jeune fille, c’était Voindrot, et je me suis mariée avec Fernand Cardonnet, mon mari donc, qui était coiffeur dans la Grand Rue. Mais il est décédé en 2001».
Il faut donc parler de la grande époque ; celle de la librairie papeterie, qu’Eliane Cardonnet tiendra de la fin des années 1960 jusqu’en 1987. Tous les anciens habitants s’en souviennent parfaitement. Aline, l’institutrice à la retraite, y était une habituée : « On venait y acheter beaucoup de choses, pas seulement de la papeterie. Les livres, mais aussi les cadeaux pour les fêtes de fin d’année, les anniversaires. C’était l’époque des romans d’aventure du fameux Bob Morane, et mon petit frère en lisait beaucoup. C’est là qu’on les lui achetait. Il y avait aussi des petits objets et bien sûr de beaux stylos à la plume en or… ».
 Mais Madame Plume d’Or a gardé le meilleur pour la fin. En effet, elle nous a préparé une énorme surprise : « Vous savez, quand j’étais petite, nous dit-elle, j’ai bien suivi à l’école, mais sans plus. Alors figurez-vous que je me suis étonnée moi-même : je me suis mise à écrire des poèmes. C’est sorti de moi, comme ça, tout seul ! Tenez, je vais vous en donner un ! ». Et Eliane Cardonnet nous fait un cadeau. C’est la première fois qu’un de ses poèmes est publié. Je vous le laisse lire. Il s’intitule Entre les pages de mon cœur.
Mais Madame Plume d’Or a gardé le meilleur pour la fin. En effet, elle nous a préparé une énorme surprise : « Vous savez, quand j’étais petite, nous dit-elle, j’ai bien suivi à l’école, mais sans plus. Alors figurez-vous que je me suis étonnée moi-même : je me suis mise à écrire des poèmes. C’est sorti de moi, comme ça, tout seul ! Tenez, je vais vous en donner un ! ». Et Eliane Cardonnet nous fait un cadeau. C’est la première fois qu’un de ses poèmes est publié. Je vous le laisse lire. Il s’intitule Entre les pages de mon cœur.
« Entre les pages de mon cœur, parmi mille feuillets jaunis, petites joies et grands bonheurs. J’ai retrouvé tous mes amis, et dès lors, j’ai fait l’inventaire de mes souvenirs les plus chers. De tous les autres, qu’ai-je à faire s’ils ont pour moi un goût amer. J’ai choisi de mettre au secret tous mes chagrins, toutes mes peines de ce qui hier m’a pu blesser pour que mon âme soit sereine. Mais l’oubli d’une seule chose dépendrait-elle de notre heur ? Puis-je ne garder que les roses entre les pages de mon cœur ? »
mél : thierry.arcaix@wanadoo.fr ; tél : 06 23 10 62 21

